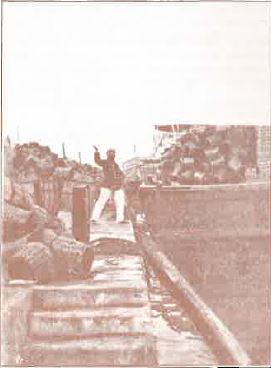Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes
Un reporter sur la ligne…en 1906: les douaniers des côtes de France
Est reproduit ici un reportage sur la surveillance des côtes par la douane réalisé en 1906. Ce document diffusé en avril 1981 dans la revue professionnelle « la vie de la Douane » faisait suite à un premier reportage sur la douane aux frontières terrestres en 1906 que nous mettrons en ligne dans une autre édition.
L’équipe de rédaction
«On pourrait croire que sur la côte il n’y a pas de fraude : la mer n’est-elle pas là comme une barrière infranchissable? Il n’en est rien, et, bien que se faisant moins facilement que sur terre, la fraude n’en existe pas moins. De même que – nous l’avons vu – la frontière terrestre de Dunkerque à Nice est gardée jour et nuit, de même, sur la frontière maritime, de Dunkerque à Hendaye, nous trouvons tout le long de la côte une ligne ininterrompue de douaniers. C’est ce service, tout aussi curieux – sinon plus – que le premier que nous nous proposons d’étudier, du moins dans ses grandes lignes.
Nous ne parlerons pas des conditions nécessaires pour entrer dans l’Administration des douanes. Le postulant admis étant indifféremment envoyé sur la côte ou sur la frontière terrestre, le recrutement est identique, nous n’y reviendrons donc pas. De même, encore ici, nous retrouvons les divisions en capitaineries, lieutenances, sous-lieutenances et leurs subdivisions en brigades. Mais, de concert avec les brigades placées le long des côtes, nous aurons en même temps une catégorie d’agents chargés spécialement du service maritime organisé pour la surveillance en mer et dans les ports des mouvements de la navigation, l’exploration et la protection des côtes.
Ce sont les «matelots» des douanes et leurs chefs directs, les «patrons» et «sous-patrons». Dans le langage douanier, c’est ce que l’on appelle la «patache». Les lieutenants et capitaines surveillent le service de ces embarcations chacun dans sa circonscription. Disons tout de suite que les fonctions de patron et sous-patron sont, à la différence du service près, les mêmes que celles des grades correspondants de brigadier et de sous-brigadier sur les frontières de terre. Le lecteur n’a sans doute pas oublié que le brigadier constituait en quelque sorte «l’âme du service».
Les matelots ne portent pas l’uniforme ordinaire de douanier. Ils ont le caban en drap bleu marine avec revers croisant sur la poitrine et dont le collet est rabattu ; le pantalon en drap bleu marine (sans la bande rouge) et le béret en laine bleu foncé du modèle adopté par la marine de l’Etat. Au lieu du nom du navire que portent les matelots de la marine de guerre, les matelots des douanes ont le mot «Douanes» en lettres jaunes sur un ruban de soie noire. Les patrons et sous-patrons ont une casquette identique à celle des premiers et seconds maîtres de la marine. Leurs galons sont en diagonale. On se propose de donner aux matelots une veste identique à celle des préposés à la place du caban de marin, et la casquette remplacerait le béret, qui ne sied qu’aux jeunes marins de la flotte.
La surveillance s’exerce en mer, sur les côtes ou à terre.
1 – En mer.
-Le rayon des côtes sur lequel s’étend la surveillance de la douane est de 2 myriamètres en mer. Le but de cette surveillance est de prévenir les versements frauduleux de marchandises par les navires qui se rapprochent du rivage de la mer ou qui remontent les fleuves, rivières et canaux, et d’empêcher également les exportations frauduleuses.
A cette fin, la loi a donné à la douane un droit de haute police dans un certain rayon, et ce droit s’exerce au moyen des embarcations des douanes. La principale de leurs attributions est d’assurer la police des manifestes (On entend par manifeste un état détaillé, en quelque sorte l’inventaire de toutes les marchandises formant lacargaison d’un navire). Tout capitaine de navire se trouvant dans le rayon est tenu de présenter son manifeste aux préposés des douanes, soit de jour, soit de nuit ; en cas de refus, il est passible d’une très forte amende.
On devine facilement que les gros bateaux sont moins suspectés que les petits bâtiments au point de vue frauduleux. En effet, une barque peut aborder la côte presque partout – chose impossible à un navire de tonnage important – et y opérer des déchargements. C’est pourquoi les préposés ont le droit de visiter tout bâtiment «au-dessous de cent tonneaux étant à l’ancre ou louvoyant», toujours, ne l’oublions pas, dans les 2 myriamètres des côtes.
Toute cette surveillance a lieu en mer au moyen des pataches. Qu’est-ce au juste que ces pataches? Elles sont de types et de tonnages très variables suivant les lieux, l’état des côtes, les habitudes de la fraude – surtout selon le genre d’embarcations employé par celle-ci ou qui a été employé au temps où la fraude sévissait encore, car la contrebande maritime organisée, prospère encore il y a une trentaine d’années, a presque disparu – et suivant aussi le service à faire qui peut être un service de longues croisières au large ou un service de stationnement de visite dans les rades ou embouchures de rivières. Sur la Manche, du côté de Granville, Saint-Malo et Cherbourg, par exemple, les pataches sont du type péniche, c’est à dire que ce sont des chaloupes légères, non pontées, gréées en bisquines, marchant à la voile et à l’aviron.
Ce type a été adopté dans la région parce qu’autrefois la fraude, qui s’exerçait très largement avec les îles anglo-normandes, se faisait au moyen d’embarcations de ce genre, qui, maniées par des équipages hardis, connaissant à fond la côte, atterrissaient grâce à leur faible tirant d’eau en tous endroits de cette côte dangereuse bordée de récifs et tourmentée par les courants.
La patache est montée par une dizaine d’hommes d’équipage, y compris le patron et le sous-pairon. Elle jauge de huit à dix tonneaux, .quelquefois plus, quelquefois moins. La vitesse par bon vent est d’environ six nœuds à la voile et de trois nœuds à l’aviron.
On a une tendance maintenant à vouloir diminuer le nombre des péniches et à les remplacer par des embarcations de plus fort tonnage, pontées, et ne marchant qu’à la voile, ce qui •permettrait de faire des croisières plus étendues et, en donnant plus de sécurité aux équipages, de sortir par tous les temps où peuvent sortir les pécheurs.
La durée des croisières est d’une demi-journée ou de toute une nuit. La patache va mouiller dans les anses sur les points favorables aux débarquements clandestins. Sur certains points, les pataches font des croisières de deux ou trois jours, et même plus ; elles sont alors d’un tonnage plus fort (14 tonneaux).
Quand la patache ne sort pas, les matelots concourent au service de surveillance avec les préposés tout en restant autant que possible près de leur poste.
2 -Surveillance des côtes
– Le littoral est protégé contre les entreprises de la fraude par une seule ligne continue de brigades dont l’effectif varie de six à dix agents . Sur les points où la côte est découpée par des baies, des anses ou des havres remontant très loin dans les terres, les postes sont pourvus de canots montés par deux matelots qui prolongent la surveillance des douaniers terriens en effectuant des croisières à l’entrée des anses et des havres.
Le service à terre s’effectue au moyen d’observations, le jour à cet effet, un ou deux douaniers sont placés en surveillance sur les points de la penthière d’où la vue embrasse une grande étendue de terrain. La nuit, des embuscades de courte durée sont placées dans les endroits où la côte est la plus facilement abordable. Pour se garantir contre les intempéries, le douanier du littoral ne peut, comme son camarade des frontières de terre, à cause surtout de la mobilité du service la nuit, faire usage du «sac à pied» et de la «chaise d’embuscade» ; ces objets de campement sont remplacés par le «capot», grand manteau en peaux de mouton recouvertes d’une toile imperméable. Le long du rivage, de distance en distance, on remarque de petites cabanes rustiques : c’est l’abri sous lequel, la nuit, le gabelou de repos va s’allonger dans son capot, pendant que son camarade fait bon quart non loin de là.
Les officiers s’assurent de la vigilance du service par de fréquentes tournées de jour et de nuit, tout comme sur les frontières de terre. Les douaniers étant, de par leur service, obligés de parcourir en tous sens la côte de jour et de nuit, ont le droit de libre parcours sur le rivage de la mer ou sur le bord des falaises à marée haute. De grandes propriétés privées clôturées s’étendant parfois sur la côte, la douane en possède une clé. Si un service doit traverser cette propriété, le brigadier qui le commande doit la lui remettre au moment du départ.
3 – Surveillance dans les ports
– Les navires qui y entrent sont soumis à une surveillance plus étroite. Une embarcation de la brigade maritime des douanes stationne à la passe des grands ports. Aussitôt arrivé à quai, le navire subit la visite.
Dans les ports, le service se répartit de deux façons distinctes :
1 . La garde des quais est confiée à des factionnaires qui sont placés de distance en distance et dont le seul but est de s’opposer à l’embarquement des marchandises sans autorisation.
2 . La garde des tentes ou magasins est assurée par des préposés chargés de surveiller les marchandises débarquées. Enfin, une brigade spéciale d’ «ambulants» exerce dans le port une surveillance spéciale analogue, quant au but, à celle de leurs camarades des frontières de terre (1),
Ici, le service est moins monotone que sur les côtes, mais, en revanche,. Il est très dur dans les grands ports. Au Havre, par exemple, les préposés de faction font vingt-quatre heures de service ; ils sont divisés en deux séries alternant par quart de trois heures en moyenne. Ils rentrent à la caserne à 5 heures du matin, assistent à l’appel de 9 heures et s’en vont, soit d’escorte, soit à nouveau de faction jusqu’à 5 heures du soir, puis couchent enfin dans leur lit et peuvent jouir d’une bonne nuit. En effet, dans leur service de faction, ils n’ont pour se reposer que la planche du corps de garde et la pèlerine comme oreiller.
A qui n’est-il pas arrivé, se promenant sur la jetée d’un de nos ports, de voir hisser le pavillon jaune par tout navire avant son entrée au port ? C’est le signal convenu pour demander la visite sanitaire. Ce qui nous amène à dire quelques mots de la police sanitaire, c’est-à-dire des mesures prises pour éviter, par mer, l’introduction en France des maladies contagieuses telles que le choléra, lapeste, etc. Les douaniers formant une véritable barrière mobile qu’il n’est pas possible d’éviter, et le littoral ayant été divisé en circonscriptions sanitaires, c’est encore à eux que l’on a eu recours pour l’exécution de ce service.
Tout navire arrivant dans un port français doit être reconnu par l’autorité sanitaire – presque toujours un officier des douanes – avant d’entrer en communication avec la terre. Ce n’est qu’une formalité – l’agent sanitaire se renseigne sur l’état de santé à bord pendant la traversée – mais la loi punit sévèrement (amende et prison) tout capitaine qui essayerait de s’y soustraire. Au cas où l’agent sanitaire le juge à propos, l’examen peut être poussé plus à fond et la visite médicale de l’équipage et des passagers peut être ordonnée.
Le service actif des douanes coopère aussi dans une certaine mesure à la partie matérielle des opérations de la visite. Il existe un corps spécial de préposés et de sous-officiers visiteurs (les emballeurs, en argot douanier) dont le rôle est d’assister le vérificateur dans la vérification des marchandises. Ce sont eux qui sondent les colis, prennent le poids des marchandises et appliquent sur les caisses vérifiées la marque MV (Marchandise Vérifiée).
C’est au service des brigades qu’incombe aussi le service d’«écor» sur les deux frontières, maritime et terrestre. On entend par là le dénombrement des colis, soit à leur débarquement, soit à leur embarquement, à leur entrée ou à leur sortie des entrepôts ou magasins. Ce service, qui, à première vue, pourrait paraître négligeable, est au contraire un des plus importants. Il garantit la prise en charge des marchandises et leur décharge à leur sortie. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être bachelier pour l’exécuter, il est difficile de le bien remplir. Aussi les bons «écoreurs» sont-ils fort appréciés de leurs chefs. Le préposé n’a qu’à vérifier avec certains papiers la marque et le numéro des colis qu’on lui présente, mais il faut aller vite. Sur les quais, certaines marchandises venant en un grand nombre de caisses analogues, il ne faut pas en laisser enlever une de plus, ce qui serait façile en raison de l’encombrement.
Le service des grands ports nécessitant un nombre considérable de douaniers, il n’est pas surprenant de rencontrer dans ces centres maritimes une agglomération de préposés de douanes pouvant paraître anormale. Leur modeste traitement, d’une part – cent vingt francs par mois, – et la cherté de la vie et du loyer, d’autre part, faisaient qu’autrefois ceux-ci habitaient le plus souvent la banlieue de leur résidence et se trouvaient par suite éloignés de leur travail.
C’est alors que l’idée vint de les caserner, idée toute naturelle, car n’avait-on pas affaire à des soldats? Aussi de tous côtés s’élevèrent des casernes sur les deux frontières terrestre (Avricourt, Givet, Petitcroix…) et maritime (La Rochelle, Calais, Dunkerque…) dont les deux plus importantes sont sans contredit celles de Marseille et du Havre. Cette dernière vaut la peine de nous y arrêter quelques instants.
C’est une véritable ville ayant la forme d’un quadrilatère de vingt cinq mille mètres carrés de superficie, possédant café, débit de tabac, écoles, jardins, square et même – ne l’oublions pas -sa musique! Le nombre des personnes qui y sont logées est d’environ deux mille cinq cents, l’effectif d’un régiment d’infanterie. Hâtons-nous d’ajouter que sur ce nombre ne figurent que sept cents douaniers, la différence représentant les femmes, les enfants, le personnel de l’enseignement, du restaurant.:. Sans entrer dans des détails de minime importance, nous dirons cependant que la caserne possède son poste de police à l’entrée principale, son officier et son sous-officier de casernement.
Les agents mariés ont à leur disposition deux ou trois pièces et greniers suivant le nombre d’enfants ; quant aux célibataires, habitant des pavillons séparés de ceux des ménages, leur dortoirs sont vastes et spacieux. Trois écoles (maternelle, de filles, de garçons) sont à la caserne.
A l’intérieur et contre le mur d’enceinte se trouvent d’immenses jardins symétriques divisés en portions cédées aux plus anciens douaniers mariés qui en sont en quelque sorte les propriétaires et les arrangent à leur guise. Certains, tout comme à la campagne, y ont élevé de petites cahutes en bois. Quand il est de repos, le douanier vient là fumer sa pipe, tandis qu’autour de lui peuvent gambader les bambins.
Un restaurant existe aussi à la caserne. Là le douanier ne paye presque jamais ses repas. Au moyen d’un numéro d’ordre, il a un compte ouvert qu’il règle au mois. Nous pouvons dire que, pour des prix minimes, il a là ce qu’il n’aurait nulle part : une nourriture saine, abondante et réconfortante. D’une façon générale, il peut se nourrir pour 1 franc 50 par jour. Une preuve certaine de la qualité est que beaucoup de ménagères n’hésitent pas à venir au restaurant y acheter les portions nécessaires à leur intérieur.
Bien qu’à la caserne le douanier ait sa pleine liberté, la discipline y est militaire. C’est ainsi que le réveil se fait au clairon le matin ; peu après a lieu l’appel par sections, lesquelles se rendent alors sous la conduite de leurs chefs aux lieux de service. De même, à sept heures du soir, après le coup de clairon, il faut que tous les enfants soient rentrés chez eux. A dix heures sonne l’extinction des feux et la porte de la caserne est fermée. Tant pis pour les retardataires un numéro d’avertissement – première peine douanière, car la salle de police n’existe pas – leur est octroyé. Les permissions de minuit sont rares et doivent être appuyées d’un motif sérieux. Nous ne pouvons passer sous silence la magnifique salle d’armes dont le coup d’œil est «féérique», pour employer l’expression d’un gabelou. Sept cents fusils Lebel se dressent contre le mur, tandis qu’au milieu de la pièce se trouvent les râteliers où s’accrochent les revolvers d’ordonnance que les douaniers portent sur eux. C’est qu’ils font l’exercice au fusil, nos douaniers, et défilent le 14 juillet – aux sons de leur musique – avec les troupes de la garnison.
Sur mer, la fraude ne se fait pas, et pour cause, comme sur les frontières de terre, en bandes organisées. Nous ne retrouverons ici que les fraudeurs d’occasion, c’est-à-dire le voyageur qui, revenant d’Angleterre, par exemple, rapportera une provision de cet excellent tabac qu’est le Richmond et qui, soit à Calais, à Boulogne ou à Dieppe, le dissimule aux yeux des douaniers de la salle de visite. Il n’est pas de marin non plus qui, revenant des colonies ou d’une traversée plus ou moins longue, ne rapporte quelque «provision de tabac», souvent plus pour offrir à ses amis que pour lui-même. D’une façon générale, nous pouvons dire que la fraude proprement dite existe peu.
Ce qui n’empêche pas les douaniers de service sur les côtes d’être attentifs aux moindres mouvements des bateaux qu’ils aperçoivent ; tout navire ancré sans nécessité est suspect.
Dernièrement, deux magnifiques saisies opérées par le capitaine des douanes de Boulogne sont venues prouver que la fraude sévissait encore sur la Manche. Nous ne pouvons passer sous silence ces deux faits d’armes douaniers. Par le bref récit que nous en ferons, on verra combien il faut à l’officier de douane d’initiative, d’audace et de courage, car souvent à la lutte contre le navire fraudeur vient s’ajouter la lutte contre une mer démontée.
Première saisie – Depuis quelques jours, un bateau belge louvoyait en vue de Boulogne. Des remorqueurs lui ayant offert de le rentrer au port furent rabroués par l’équipage. Une surveillance spéciale organisée amena la capture du bateau, qui fut surpris certain soir de grosse mer par les douaniers montés sur un canot léger emprunté aux pilotes par le capitaine des douanes. Le chargement consistait en 60 ballots de tabac du poids de 3 tonnes.
Deuxième saisie – Peu après cette première saisie, deux bateaux, dont l’allure et les manœuvres ne s’expliquaient pas, évoluaient au large de Calais, du côté du phare du Waldan. On supposa qu’ils étaient fraudeurs. Le capitaine des douanes de Boulogne, prévenu n’ayant à sa disposition qu’un côtre de trois tonneaux, requit un remorqueur pour explorer la côte. Et, en pleine nuit, à 25 milles de Boulogne, nos douaniers distinguèrent une voile et enfin un bateau, au flanc duquel était un canot monté d’un homme arrimant des ballots qu’il recevait du bord. Le remorqueur s’arrêta contre ce bateau sans feu,qui fut capturé. Il renfermait 1 000 kilos de tabac.
Le capitaine Commant reçut de l’administration des «félicitations pour le zèle et l’habileté dont il avait fait preuve dans la répression de la contrebande». Il arrive aussi que le navire fraudeur, s’apercevant qu’il est découvert par la douane qui fui donne la chasse, essaye de gagner le plus vite la haute mer, où la douane française n’a plus d’action sur lui. C’est ce qui arriva, le 25 mars 1905, au sloop Flandre, de la douane de Dunkerque. Voyant que le navire belge poursuivi allait disparaître en haute mer, une embarcation légère luttant de vitesse et montée par les douaniers rattrapa le bateau belge. Les douaniers grimpèrent à l’abordage et firent- non sans peine – l’équipage prisonnier. Dans les cales du sloop belge furent saisis 33 paquets de 60 kilos de tabac de Moravie.
Une fraude très active se faisait autrefois par voiture sur les marais salants où de sérieux combats furent livrés entre douaniers et contrebandiers (en entendant par contrebande l’enlèvement non autorisé du sel). Chacun sait que les sels sont frappés d’une taxe intérieure à la sortie des marais salants. Sur les côtes, la douane est chargée de la perception de cette taxe. Et de même que l’on garde la penthière, de même on gardera les chemins conduisant aux marais salants de façon à s’opposer à toute extraction irrégulière de sel. Les sauniers possèdent des endroits couverts où se trouvent quelquefois plusieurs quintaux de sels.
C’est de là que les sels sont chargés sur voiture et doivent être conduits au bureau de douane le plus proche pour y acquitter les taxes prescrites par la loi. De même que le rebat a lieu chaque matin sur les frontières de terre, de même chaque jour est effectuée la reconnaissance de l’état des camelles – ou piles de sel, en terme douanier.
Nous avons vu combien était pénible l’existence du douanier à la frontière terrestre ; cependant, le douanier maritime a encore une vie plus agitée, et nous dirons même plus dure que la sienne. Celui-ci, en effet, s’il n’est pas matelot, passe tout son service, soit au bord de la mer sur quelque roche ou sur quelque falaise d’où il peut surveiller l’horizon, soit sur les quais des ports. Dans les deux cas, il est donc mieux placé que personne pour voir le premier les accidents et les naufrages. C’est ce qui fait que – la fraude étant, nous l’avons vu, très difficile à effectuer par mer – il est encore plus sauveteur que douanier.
Et de même que la présence des douaniers le soir au coin d’un bois sombre sur notre frontière de l’Est rassure le voyageur attardé, de même leur présence sur les quais est comme une garantie contre l’accident. Nous voici donc amenés au rôle du douanier sauveteur. C’est ici que nous trouvons la plus belle page de gloire du corps des douaniers maritimes.
Tous les douaniers en service de faction sur les quais portent un engin destiné à sauver les personnes tombées à la mer. Il s’agit de la ligne Brunel, du nom de l’inventeur,ancien lieutenant de douanes.
La ligne Brunel se compose essentiellement d’un flotteur ou manchon de bois tronc conique long de 0m12 à 0m17, dont le milieu est traversé par une tige métallique terminée à une extrémité par un anneau et à l’autre par un grappin. A ce dernier est fixée une cordelette très résistante qui va ensuite s’enrouler autour du bâton. Le tout est renfermé dans un étui cylindrique en cuir que l’on attache à la garde de la baïonnette ou que l’on passe dans le ceinturon du revolver ; l’ensemble ayant l’aspect – en plus petit – du bâton dont disposent les gardiens de la paix du service des voitures à Paris.
Le douanier aperçoit-il une personne en danger de se noyer, il peut alors s’en servir de deux manières : si la personne, n’étant pas à bout de forces, se tient bien à l’eau, mais est entraînée pour une cause ou une autre, il garde le grappin en main, déroule quelque peu la cordelette et lance au désespéré le bâton qui, faisant flotteur, n’a pas de peine à être saisi par lui. Il n’y a plus alors qu’à le tirer hors de l’eau. Si, au contraire, la personne ne peut résister à la mer et se noie infailliblement, le douanier garde le bâton à la main et lance le grappin sur la personne.
Dans les deux cas, il soulève la personne en danger au moyen de la ligne, et s’il n’y a pas d’escalier proche où il puisse la traîner sans cesser de la maintenir à la surface de l’eau et aller la recueillir, il attend le secours d’autres personnes, car la ligne est naturellement trop faible pour remonter une personne sur le quai.
Toute cette manœuvre se fait en quelques secondes, et le système est facilement lancé à 40 mètres de distance. Il est ainsi opéré annuellement une moyenne de deux cent cinquante à trois cents sauvetages. C’est dire que la ligne Brunel est d’un usage courant et qu’il ne se passe pas de jour où on ne lui doive quelque vie. Il y a quelques années, à La Rochelle, vers le mardi-gras, sept personnes furent sauvées en six jours de temps, dont trois le même jour, en quatre heures !
C’est encore aux douaniers qu’a eu recours la Société centrale de sauvetage destinée à porter secours sur les côtes en cas de naufrage aux personnes et aux bâtiments. Cette Société, fondée en 1866 sous le patronage du ministre de la Marine, a établi des postes – au nombre de cinq cents environ – pourvus de tous les engins de sauvetage connus à ce jour et dont la valeur est de plusieurs millions. Disons immédiatement que le nombre de personnes sauvées par elle au 1er mars 1906 dépassait quinze mille, chiffre éloquent par lui-même. La question «matériel» étant résolue, il fallait trouver des bras solides pour l’utiliser. Les douaniers étaient tout désignés : eux seuls connaissent la côte dans ses moindres replis, et nous ajouterons, eux seuls ont un dévouement au-dessus de tout éloge.
L’énumération des engins de sauvetage mis à leur disposition serait trop longue; cependant, il ne nous est pas possible de passer sous silence le fusil et canon porte-amarres, les ceintures de sauvetage et les bâtons plombés.
Le fusil porte-amarres est un ancien fusil de rempart modèle 1840 et 1842, du poids de 5 kg 500, du calibre de 20 mm 5 et se chargeant par la bouche. Avec cette arme, on lance, en guise de projectile, à une distance de 70 à 80 mètres (dans de bonnes conditions), une flèche en bois de 1m10 de longueur garnie de culots en cuivre aux extrémités. A cette flèche est fixée, au moyen d’un système de coulant, d’attaches et de demi-clés dont le glissement amortit la secousse de départ qui pourrait la faire rompre, une ligne légère destinée à établir une communication avec un navire naufragé, une embarcation ou un homme en danger. Cette première communication établie, on peut, s’il est nécessaire, passer un cordage beaucoup plus fort appelé «hale à bord» qui permet de hâler l’embarcation en danger ou d’établir un va-et-vient pour sauver l’équipage.
Le canon porte-amarres est un petit canon en bronze se chargeant par la bouche, et autrefois employé par la marine. Il est monté sur roues. Son poids est de 85 kilos et son calibre de 0 m 053. Il lance à une distance de 3 à 400 mètres un projectile en fer de forme cylindro-ogivale et du poids de 8 kg 500 auquel est attachée, au moyen d’un système de nœuds coulants, servant également à amortir le choc de départ, une ligne légère destinée à établir une première communication avec le navire naufragé. Au canon est joint un matériel complet de va-et-vient placé dans un chariot et arrimé toujours prêt à partir. Le tout est remisé dans un abri.
A la première nouvelle d’un naufrage, le chef de poste réunit ses hommes ; le chariot derrière lequel on attache le canon est attelé, au besoin les hommes commencent à le traîner, et on gagne en toute hâte le lieu du sinistre.
Le chariot est arrêté en arrière du lieu où doit se faire le tir ; le matériel de tir et les lignes placées dans des caisses et toutes prêtes pour le lancement sont mises à terre. Le canon est aussitôt mis en batterie, pointé et chargé ; une première ligne est lancée en visant entre les mâts du navire naufragé si le tir a lieu droit, à contre-vent. Dans tous les cas, le tir doit avoir lieu de façon que le projectile tombe au delà du navire en détresse en passant au-dessus ou en dehors, selon le cas, c’est-à-dire selon la direction du vent, et que la ligne s’abatte à bord le long des mâts.
Une première communication est ainsi établie avec les naufragés. On leur fait alors passer successivement d’autres cordes avec les indications nécessaires pour s’en servir, inscrites en plusieurs langues différentes sur de petites planchettes. On obtient ainsi un système de va-et-vient qui est manœuvré complètement par les sauveteurs à terre ; les naufragés n’ont qu’à se placer successivement dans une espèce de culotte attachée à une bouée circulaire en liège qui fait la navette entre le navire et la côte.
Le personnel des brigades de douanes qui possèdent un poste de fusil ou de canon porte-amarres est mis et maintenu au courant de la manœuvre des engins de sauvetage au moyen d’exercices périodiques dirigés aussi souvent que possible par les officiers.
Le matériel de tir et de va-et-vient est complété par des ceintures de sauvetage et par des bâtons plombés munis d’une ligne qu’on lance comme un plomb de sonde ou une fronde (c’est-à-dire en le faisant tournoyer plusieurs fois verticalement) et qui servent à établir une communication à courte distance (20 ou 30 mètres).
Les canons et fusil porte-amarres servent peu souvent dans les sauvetages, la côte étant garnie d’un nombre suffisant de canots de sauvetage qui ont une efficacité plus grande. Mais, indépendamment des services qu’ils rendent avec les engins mis à leur disposition par la Société centrale de sauvetage, les agents des douanes contribuent à de nombreux sauvetages maritimes, soit en donnant presque toujours les premiers – surtout la nuit – les avis de naufrage, soit en aidant à la mise à l’eau des canots de sauvetage de l’équipage desquels les matelots des pataches font très souvent partie.
Tous, officiers, préposés ou matelots sont dignes d’admiration. Devant le danger, ils n’hésitent pas et, sans calculer, se jettent à l’eau, parfois tout équipés, pour porter secours à autrui.
Nous ne citerons que deux faits, mais qui sont suffisamment éloquents par eux-mêmes ; les sauvetages auxquels participèrent le lieutenant Bastel et le brigadier Wacongne, tous deux à Boulogne.
Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1883, vers quatre heures du matin, deux préposés des douanes de service entendent des cris de détresse et aperçoivent bientôt tes feux d’un navire que la tempête a jeté sur les écueils. C’est le trois-mâts buédois Renown, qui, assailli par une mer furieuse, vient de s’échouer à 1 500 mètres du poste des douaniers des Hemmes et à deux kilomètres de la dune. Les préposés donnent l’alarme, un coup de canon est tiré pour faire savoir aux naufragés qu’on les a aperçus.
Nous ne pouvons mieux faire que reproduire les termes mêmes du récit qu’en fit M. Ingerbrans, rapporteur de la Société des Sauveteurs du Nord, en remettant au lieutenant Bastel la médaille d’or qui lui était décernée :
«Vers six heures, l’obscurité était profonde et le navire n’apparaissait plus que comme une masse confuse au milieu de la brume épaisse. La mer, qui commençait à monter, déferlait avec fureur sur le Renown, des appels désespérés ne tardèrent pas à se faire entendre. M. le lieutenant Bastel, n’écoutant que son courage et sans calculer les dangers auxquels il allait se trouver exposé au milieu des débris ballottés par une mer furieuse, n’hésita pas à se mettre à la nage et parvint, après les plus pénibles efforts, à atteindre le navire ; soutenu par un tronçon de mâture, il fut vu par les naufragés, qui lui lancèrent une amarre, il s’en saisit, se l’enroula autour du corps et se remit à la nage pour revenir au rivage, qu’il atteignit sans peine, grâce à l’assistance dévouée du brigadier Garnier, qui, bien que faible nageur, s’était porté à sa rencontre en se mettant à l’eau jusqu’aux épaules, suivi des préposés Vasseur et Malingre, qui n’hésitèrent pas non plus à s’aventurer au milieu des vagues, pour assurer le succès de la périlleuse entreprise de leur héroïque lieutenant. L’amarre qu’il apportait fut alors raidie par les soins de tous les agents des douanes présents, la communication ainsi établie avec le Rénown, les dix hommes de l’équipage, y compris le capitaine Gustafson, se laissant glisser le long de !a corde, purent débarquer sains et saufs. Peu après, la mer submergeait complètement le navire. Ce fut seulement quand le dernier naufragé arriva à terre que M.Bastel put changer de vêtements, après être resté, pendant deux heures, exposé à la pluie, à un vent glacial et surtout au danger d’être emporté par les lames…».
Non moins émouvant est le sauvetage accompli par le brigadier Wacongne la même année. Deux préposés de service aperçurent vers trois heures du matin un navire échoué sur la pointe de Wimereux. La mer est déchainée. Ils vont chercher des secours, mais avant que ceux-ci arrivent, trois hommes ont déjà été emportés par les lames ; seuls, le capitaine et un matelot se cramponnent encore au mât de beaupré… Le canon porte-amarres est vite installé ; une première flèche atteint l’arrière de la goélette, la deuxième se brise et la troisième tombe exactement à l’avant où se trouvent les naufragés; mais ceux-ci sont à bout de forces et ne peuvent la saisir.
Sans hésiter un seul instant, le brigadier Wacongne se jette à la mer et, aidé de la ligne, il atteint le navire non sans avoir plusieurs fois failli être emporté par les vagues. Les deux survivants furent ramenés à terre inanimés.
Tous les ans, du reste, la Société centrale de sauvetage n’oublie pas ses valeureux serviteurs. L’an dernier encore – le 13 mai,- à la distribution solennelle des récompenses qui eut lieu à la Sorbonne, sous la présidence du vice-amiral Duperré, assisté de MM.Pallain, ex-directeur général, et Brunet, directeur général des douanes, nombre de douaniers obtinrent des prix comme les années précédentes. Le prix Emile Robin fut décerné au préposé Leclerc, qui, de surveillance sur le quai de Toulenhéry (Côtes-du-Nord), le 12 septembre 1905, se jeta à l’eau tout habillé et équipé pour sauver à la nage un enfant tombé dans le port : paralysé par l’étreinte de l’enfant et emporté vers le large par le courant, il aurait couru grand risque de se noyer lui-même sans l’intervention d’un deuxième sauveteur, le jeune Guiziou, fils du patron des douanes, qui se jeta également à l’eau et aida Leclerc dans ‘son sauvetage, que tous deux parvinrent à mener à bien.
Le deuxième prix Emile Robin fut accordé au brigadier Guyot, qui, le 10 juillet 1905, sauva un épileptique jeté dans la Loire à Couéron (six mètres de profondeur à marée basse). En 1897, il obtenait déjà une médaille d’argent pour un sauvetage à Rouen dans un incendie.
Il ne se passe pas de semaine que les annales des douanes n’enregistrent de sauvetages de toutes sortes opérés par les douaniers. Leur nombre en est trop élevé pour les citer tous.
D’une façon générale, là où il y a des douaniers, là se trouve le courage. Que ce soit sur terre ou sur mer, le douanier – ou son officier, nous l’avons vu – n’hésite pas. Combien de chevaux emballés qui auraient causé les pires malheurs sans leur intervention ? Combien d’incendies n’ont été de peu d’importance que grâce à eux? Il n’est pas jusqu’aux aéronautes qui ne leur doivent la vie.
Et comme récompense de tant d’abnégation et de dévouement, ces héros obscurs reçoivent un «témoignage de satisfaction», une «mention honorable» ou plus rarement une médaille.
Au douanier peuvent s’appliquer ces paroles de M. Deschanel, qui, dans son rapport sur les prix de vertu le 23 novembre 1905, disait du brigadier des douanes Guyomard :
… « Il sauve une vie chaque jour. Tranquille dans la colère de la nature, il regarde la tempête et la mort fixement. Quand la mer se calme, il court aux incendies, sauve les gens qui brûlent, arrête les chevaux emportés ou les vagabonds dangereux : c’est l’acharnement du bien contre l’acharnement du mal »…
Ed. Laval
(Extrait du «Mois littéraire et pittoresque»)
Cet article nous a été aimablement communiqué par René ROUS, Chef de subdivision à Tarascon sur Ariège. (NDLR 1981)
N° 186 – Avril 1981