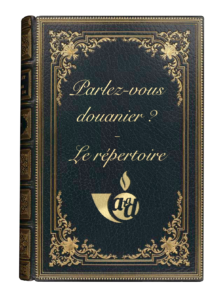Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes
Parlez-vous douanier ? : Le répertoire (mise à jour 06/2024)
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
A
Acquit a caution
Pièce de la régie qui permet la libre circulation des marchandises soumises à l’impôt indirect sans l’avoir acquitté.
Admission temporaire
Régime douanier permettant l’importation en suspension des droits et taxes de marchandises en l’état ou destinées à subir une transformation ou une ouvraison.
Andouille / andouillette
Sacs de tabac ayant la forme de ces charcuteries. Ou aussi : Pouquetou de p’tun : nom de ce sac de tabac utilisé dans le Cotentin (cf ouvrage Sur les chemins de contrebande de Dominique Roger, Editions Rustica.
Apparition
Ce terme n’avait malheureusement rien d’un miracle. Il était utilisé dans les brigades de douane chargées de la surveillance du littoral côtier ou de la surveillance des “intervalles” (entre les points de passages gardés) sur les frontières terrestres. Il était fixé à “l’escouade” de patrouille par l’ordre de service et consistait à fixer un lieu (point d’apparition) et une heure de rendez-vous aux agents sur le parcours de leur surveillance mobile afin que le chef de Poste puisse venir s’assurer de la correcte exécution de ses instructions, ce qu’il ne faisait d’ailleurs pas systématiquement. Mais dans le doute, les agents devaient s’y conformer avec ponctualité. Cette méthode de contrôle hiérarchique s’appliquait aux patrouilles mobiles à pied et a perduré jusqu’à l’avènement de la radio VHF (milieu des années 1950/60) et à l’arrivée de moyens automobiles.
Aubette
Édicule élevé sur la voie publique.
De nombreux exemples d’aubettes des douanes, permettant l’installation du service sur les voies secondaires, ont été réalisés, tantôt le long de la route concernée, tantôt en son milieu pour mieux contrôler les deux sens de circulation.
Avis de passage
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Aviseur
Il s’agit en terme administratif (XVIIIe) spécifiquement douanier désignant une personne donnant un avis de fraude « indic » ou « cousin » chez les policiers. Les contrebandiers le dénommaient la « chandelle ». L’aviseur permet aux douaniers de réaliser de belles affaires. Il touchera une quote-part de l’amende infligée appelée la « part d’intervenant », les textes prévoyant la rémunération des aviseurs remontent à l’ancien régime. Le statut de l’aviseur est défini à l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 1957 modifié par l’arrêté du 21 novembre 2007, réglementation elle-même prise en application de l’alinéa 2 de l’article 391 du code des douanes prévoyant la répartition du produit des amendes et confiscations.
Avitaillement
Approvisionnement d’un navire ou d’un aéronef en produits pétroliers pouvant être exonéré de droits de douanes et de taxes intérieures.
B
Dit aussi lit d’embuscade (milieu XIXe) ou châlait, ce lit pliant formé d’un cadre de bois et de cordes ou de toiles tendues se repliait et se transportait sur le dos. Il été utilisé par les agents pendant les heures d’attente lors des embuscades.
Banlieue
Ensemble des localités environnant une ville. Fiscalement zone de trois lieues (environ 14 km) autour des villes soumise à réglementation spécifique pour le commerce des vins depuis l’ancien régime.
Barrière
Obstacle et porte d’entrée des villes où l’on percevait l’octroi, ou des états où était installé un poste de douane. Le reculement des barrières (douanières) aux frontières du royaume a supprimé les frontières intérieures à la révolution française. Le reculement des barrières douanières aux frontières extérieures de l’union européenne a supprimé les frontières intérieures entre états membres en 1993.
Bataillon douanier
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Battelée
Contenu d’un bateau chargé de tabac de contrebande, usité principalement sur les côtes de Basse-Normandie et du cotentin
BCNJ (bureau à contrôle nationaux juxtaposés)
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Bête à 4 cornes
Nom que les contrebandiers franc-comtois donnaient à leur lourd paquetage de toile (25 à 35 kg) chargé sur le dos, les 4 coins saillants permettaient une meilleure prise en mains.
Blatte
Paquetage sanglé au poitrail d’un chien contenant des marchandises de fraude, généralement du tabac. Le chien était utilisé comme passeur. Cette pratique s’est répandue à partir du XVIIIe siècle en particulier dans le nord et l’est de la France. Les douaniers disposaient de chiens dressés à suivre et attaquer leurs congénères fraudeurs.
Blocus
Interdiction des communications avec l’extérieur d’une ville, d’un état, d’un ensemble. Les plus connus furent le blocus maritime décidé par le gouvernement anglais auquel succéda le blocus continental décrété par napoléon 1er, puis le blocus des états confédérés du sud des états unis par ceux du nord.
Bona Fide
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée. .
Bornage
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Borne
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Bouchon
Morceau de liège pour boucher une bouteille. Enseigne rendue obligatoire à la porte des débits de boissons par une ordonnance du XVIIe siècle. Par extension, nom donné aux débits de boisson lyonnais.
Bricote
(XIXe) : nom donné à la petite contrebande, en Franche-Comté, perpétrée par les enfants et les femmes que l’on nommait les « bricotières ». Ce trafic portait sur de petites quantités de marchandises (café, sucre, chocolat, tabac, allumettes au phosphore, jeux de cartes ou pierres à briquet) en provenance de suisse. Pris par les douaniers, leurs marchandises de fraude étaient confisquées. Tout au plus, étaient-ils fichés comme « pacotilleurs avérés, dévalisés et relâchés ». La « brecote » désignait en jargon douanier, une petite quantité de marchandises prohibées.
Brûlement
Destruction par le feu des marchandises anglaises. Dans le cadre du Blocus Continental instauré par le décret de Berlin du 21 novembre 1806, le décret de Fontainebleau du 10 octobre 1810 impose le « brûlement » des marchandises anglaises saisies.
C
Caducée
« Insigne de héraut » d’un point de vue étymologique, le caducée est composé d’une baguette surmontée de deux ailes autour de laquelle s’entrelacent deux serpents, et ne doit pas être confondu avec le bâton d’Esculape (Asclépios), autour duquel est enroulé un unique serpent, qui est l’insigne des professions médicales. Attribut des divinités tutélaires du commerce dans l’Antiquité grecque (Hermès) et romaine (Mercure), ce symbole de paix, de concorde et de prospérité, a souvent été choisi comme emblème douanier, représenté sur les édifices administratifs (ornant les frontons des anciens hôtels des douanes de Bordeaux et Rouen, écusson surplombant la porte principale des douanes de La Havane), les documents (cachets sous la Première République, vignettes de contrôle sous la IIIe République), les armes et uniformes (gardes d’épée des douanes impériales, plaques des shakos sous la Monarchie de Juillet), ainsi que les écussons des douaniers hongrois, polonais, lituaniens, slovaques et ukrainiens.
Carotte
Tabac torsadé et prêt à l’emploi, soit pour la pipe, soit pour la prise, soit pour la chique. La carotte est devenue l’enseigne des débitants de tabac en France.
Catula
Sobriquet 19è utilisé dans les salines du Morbihan, désignant les employés des douanes, en raison de leur question lors des contrôles « qu’as-tu là ? »
Chasseurs verts
Surnom des douaniers attribué par napoléon en raison de la couleur de leur uniforme, le “vert finances” à l’époque.
Chausse-trappe
Piège à animaux composé d’une trappe dissimulée par un trou recouvert de feuilles. En matière de contrebande, ce sont des clous de fer aciérés jetés en grand nombre sous les roues des voitures de douane.
Chiens de fraude “blattes”
Il s’agissait de chiens d’assez forte corpulence et endurants. Ils étaient dressés pour rallier un point en Belgique à un point en France (l’inverse se faisait aussi). Munis d’un collier à pointe pour se défendre contre les chiens des douaniers, ils transportaient dans des sacoches placées sur chacun de leur flanc les marchandises de fraude (le plus souvent du tabac, du café,…). Souvent lâchés de nuit, privés de nourriture pendant 24 heures, ils ralliaient leur destination au plus vite pour recevoir leur pâtée.
Clou (au clou !)
La « mise au clou » consistait à indiquer au déclarant qu’un document ou une énonciation de la déclaration était manquant et que, par conséquent, la déclaration était irrecevable. Cette expression tire son origine du clou sur lequel était réellement épinglée la déclaration et est désormais désuète compte-tenu de l’informatisation et la dématérialisation des déclarations.
Code
Ensemble des lois et décrets régissant une matière déterminée. L’ordonnance de Colbert de 1680 et les baux successifs d’affermage des droits indirects constituent les prémisses du code des douanes.
Colporteurs
Terme retenu par l’administration des douanes au XIXe désignant un ou deux fraudeurs chargés de plus de cinq kilogrammes de marchandises prohibées ou de plus de dix mètres de tissus.
Commission d’emploi
Titre d’attribution d’une fonction par une administration. Les douaniers, et ce depuis l’ancien régime, doivent en être porteurs en permanence pour justifier de leur fonction. “appelées plaques de baudrier” : Avant cela, des plaques métalliques appelées plaques de baudrier servaient aux agents pour s’identifier. L’obtention d’une commission d’emploi en douane est soumise à prestation de serment devant un juge.
Conduite en douane
Ensemble des dispositions légales ou réglementaires à respecter pour présenter les marchandises au service des douanes.
Confiscation
Transfert à l’état de la propriété de biens ou de marchandises par suite d’une décision de justice.
Congé
Acte écrit délivré par une administration pour le transport d’une marchandise soumise à un droit de circulation.
Congé d’affaires
Avant l’institution des congés ( 1853 sous Napoléon III pour les fonctionnaires , puis 1936 pour tous les salariés sous le Front populaire), les douaniers ne bénéficiaient que de permissions exceptionnelles pour raison de santé ou affaires personnelles. C’est l’origine de l’expression administrative encore conservée « congé d’affaires” pour qualifier les congés annuels issus des lois de 1956 (3 semaines) 1968 (4 semaines) 1982 (5 semaines).
Contremarches
Technique employée par les agents des douanes pour tromper les fraudeurs. Elle consiste à revenir sur ses pas ou bien à prendre la direction inverse de celle suivie précédemment.
Coulomb
Dans le nord (Halluin-Rekkem) au guichet des carnets ATA d’un bureau de douane, l’agent visiteur avait pour habitude de dire : « ah, j’ai un coulomb ! ». En fait, les coulombs sont les pigeons voyageurs. il existe de nombreux colombophiles dans le nord et en Belgique qui participent a des compétitions, y compris internationales. Le dédouanement de camions entiers de pigeons belges était effectué le samedi matin sous le régime de l’admission temporaire; l’apurement se faisait « bona fide » par le retour des pigeons en Belgique.
Le terme « Coulomb » désignait plus généralement toute personne extérieure au microcosme douanier (douaniers, transitaires, chauffeurs routiers…) se présentant au service.
Coureur de nuit
Surnom des contrebandiers en Loire-Atlantique et Vendée (ancien régime)
Coutume
Règle de droit tirant sa valeur d’un usage général et prolongé. Le droit de coutume était perçu sur les boissons aux entrées de Rouen (coutumier de 1682).
D
Déquarantehuitable ou D48able
Expression très courante pour désigner le document qui peut ne pas être présenté par le déclarant lors du dépôt d’une déclaration en douane. Un engagement souscrit à l’aide de l’imprimé D48 est alors présenté afin de produire le document concerné après le passage en douane (en général délai d’un mois).
Douane volante
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
E
Eclaireur
Contrebandier chargé de pousser les douaniers à se découvrir et à les poursuivre. Ils portent pour les tromper des ballots, généralement remplis d’herbe (XIXe).
Ecor
Comptage de colis ou de marchandises à l’embarquement ou au débarquement de navires, de moyens de transport.
Embargo
Interdiction d’exporter ou d’importer certaines marchandises ou d’utiliser les services de sociétés de nationalité déterminée. Les embargos les plus récents ont frappé l’Afrique du sud, la Yougoslavie, la Lybie, l’Iran.
Embuscade
Terme datant du XVIIe, désignant, l’attente des agents (un ou deux) à un point donné afin et d’intercepter les contrebandiers.
Entrepôt
Lieu, magasin où l’on stocke les marchandises. Régime douanier économique. S’est développé au XIXe siècle et au début dans les grandes villes.
Escorte (l’)
Jusque dans les années 50 le déplacement des marchandises sous douane dans les enceintes portuaires avait lieu sous escorte effective des agents des douanes puis, le transfert s’opéra sous le couvert de la seule déclaration de douane. Aujourd’hui une transaction informatique suffit.
Escouade, Chef d’escouade
Terme douanier, issu d’un vieux terme militaire, désignant l’équipe et son chef, chargée d’une mission ponctuelle de contrôle mobile ou en poste frontière. Bien que dans l’armée une escouade correspondait autrefois à un groupe d’environ 8 soldats, dans les brigades des douanes, l’escouade était le plus souvent composée de deux 2 douaniers seulement.
Espèce
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Espion
Contrebandier, souvent un chef de bande, chargé de prévenir de l’arrivée des douaniers au moyen de chansons, de sifflets.
F
Faire une petite (vacation)
Dans les ports les agents des douanes avaient la possibilité de recourir aux heures supplémentaires rémunérées dites Travail extra légal, travail rémunéré ou Travail hors d’heure. Lorsque le chargement ou déchargement était terminé plutôt que prévu les douaniers comme les dockers étaient payés sur la vacation programmée ( 19-1 ou 1-7).
Fardage
Manipulation qui consiste à réunir plusieurs colis en un seul pour échapper à la taxation; une infraction sanctionnée par la « police des manifestes ».
Fasqueline
Instrument mis en service sous la Restauration dans le cadre d’une réforme du mesurage des quantités de sel portant à la fois sur les contenants et sur la façon de les dénombrer. La fasqueline permettait aux agents chargés du contrôle de procéder aisément au décompte des sacs de sel.
Pour en savoir plus : La fasqueline
Faux saunage et par extension Faux saunier
Trafic du sel est apparu avec l’instauration de la gabelle. Il s’est pratiqué jusqu’à sa disparition.
Les règlements de la ferme distinguaient deux catégories, ceux qui transportaient la marchandise prohibée sur leur le dos, les « porte-à-col, porte-col ou coloyeurs » (XVIIe) et ceux avec « équipage » (chevaux, mulets, charrette, bateau…). Les faux sauniers portecol, les plus nombreux, se déplaçaient à pied et pratiquaient donc de la contrebande de petite envergure. Approvisionnés par des professionnels du faux saunage, ils vendaient de porte en porte. A la fin du XVIIIe, le faux saunage féminin s’accrut et devint parfois majoritaire (ouest).
Faux sel
Ce mot désigne le sel de contrebande, il s’agit bien entendu du même sel que celui des greniers. Ce faux sel échappait entièrement au contrôle des gabelous. Sel de contrebande dit « sel de lune» en pays de la Loire et en Vendée.
Ferme Générale
En France, sous l’Ancien Régime, les impôts indirects étaient affermés par province et par produit. La pratique de l’affermage consistait à confier le calcul et la perception de l’impôt à des sociétés privées qui agissaient au nom du roi. En contrepartie, ces sociétés versaient au trésor royal un capital fixé dans un bail. Au fur et à mesure de son affirmation, le pouvoir royal procéda à la rationalisation et à la concentration de cet affermage en un bail unique passé avec une compagnie de financiers connue sous l’appellation de « Ferme générale du Roi » entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Si la ferme générale est généralement considérée comme « l’institution la plus honnie de l’Ancien Régime », elle devint un modèle d’organisation administrative qui a donné à la régie nationale des douanes, qui lui est substituée à la Révolution, et à la direction générale des douanes et droits indirects actuelle, ses principes juridiques et organisationnels fondamentaux.
Francisation
Acte donnant la nationalité française à un navire.
Fraude
Agissement ou dissimulation visant à faire obstacle à l’application des lois douanières ou fiscales. L’administration a longtemps considéré comme fraudes les actes ayant pour but de minorer la perception des droits de douane lors des déclarations dans les bureaux. A contrario, un passage de marchandises en dehors des bureaux était considéré comme de la contrebande.
G
Gabelle
Impôt indirect frappant les marchandises. La plus connue a été la gabelle du sel qui a constitué sous l’ancien régime une part très importante des revenus de l’état. Cet impôt est mentionné pour la première fois en 1244 dans une ordonnance de saint louis. D’abord temporaire, cette taxe devint permanente avec les Valois, Philippe VI transformant, à partir de 1340, la vente de sel en monopole royal. Elle constitua le principal impôt indirect de l’ancien régime. En 1681, Colbert réorganisa le système fiscal, remplaçant les greniers à sel par la ferme générale. Cet impôt spécifique a disparu sous la ive république, l’assemblée constituante le supprime par la loi du 31 décembre 1945.
Gabelou
1585 : Forme dialectale (ouest) de gabeleur (1548), ou encore gableux, désignant un commis de la gabelle (termes péjoratifs). Ils étaient appelés « archers de la gabelle » (XVIIe) en langage administratif. Le terme ordinaire pour désigner de simples agents de la ferme, est « employé » ou « garde » (savary des bruslons, dictionnaire du commerce, 1750). Par extension, gabelou a désigné un employé de l’octroi et un employé de la douane (1807).
Gapian
Nom donné aux membres des agents de la ferme dans le nord de la France (terme péjoratif du XVIIIe).
Garance
Plante tinctoriale fournissant une substance colorante rouge. D’abord importée en Europe, elle fut ensuite acclimatée dans le sud de la France. Elle a donné son nom au passepoil, puis à la bande ornant le pantalon des douaniers.
Guidon
Le guidon ou guidon des douanes est le pavillon arboré par les bâtiments des douanes garde-côtes (notamment ses patrouilleurs et vedettes). Il a été défini et réglementé par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 12 janvier 1962. Cette « marque de la douane » est constituée depuis lors d’un guidon de couleur verte.
Gros
Registre douanier d’enregistrement des déclarations sommaires. Le droit de gros a été perçu lors de la vente en gros des marchandises depuis 1356.
H
Hypothèque
Document qui garantit un créancier sans déposséder le propriétaire. Depuis la révolution française, les receveurs des douanes étaient conservateurs des hypothèques maritimes prises sur les navires. Ce régime a pris fin en 2017.
I
Inscription de faux
Procédure visant à contester la véracité d’un acte authentique. Les procès-verbaux de douane établis par deux agents font foi jusqu’à inscription de faux.
J
Jauge
Volume d’un navire. Le service des douanes a été chargé de son établissement depuis 1791. Cette caractéristique a constitué l’assiette de droits perçus sur les navires. Cette mission a pris fin depuis une dizaine d’années.
K
L
Lettre de voiture
Document établissant un contrat de transport par voie terrestre
Ligne Brunel
Matériel de sauvetage maritime inventé par Joseph Brunel, lieutenant des douanes. « Le 22 juillet 1874, le Ministre le remercie et prescrit l’emploi de la ligne Brunel dans les ports français. « Il s’agit d’une ligne de corde brune, embobinée sur une bobine de bois, terminée par un grappin et enfermée dans un étui de cuir qu’une anse permet de suspendre à la ceinture ou à la poignée d’une baïonnette » (M. Boyé). Cet outil servait également à attraper les ballots jetés ou tombés à la mer.
Ligne, Ligne de douane
Historiquement, la ligne constitue un dispositif douanier de surveillance des marchandises franchissant les frontières, un cordon fiscal constitué de bureaux chargés du dédouanement des marchandises conduites en douane et de brigades chargées d’intercepter celles introduites en contrebande. Cette notion désigne, dans le jargon corporatif, le terrain d’action des agents en contact direct avec les marchandises, les déclarants et les fraudeurs par opposition à ceux affectés dans les services supports. Être “sur la ligne” est devenu synonyme d’ « être sur le terrain ».
Lit d’embuscade
M
Mainlevée
Acte donnant la libre disposition des marchandises après déclaration ou saisie ou encore d’annulation d’une hypothèque.
Manifeste
Liste sommaire des marchandises à bord d’un navire.
Marmotte
Petite caisse en bois conservée à l’unité où étaient enfermés sous clé les ordres de mission des douaniers partant en service « à l’embuscade » (XIXe). Cet usage servait à garder les informations stratégiques confidentielles pour lutter contre toute compromission d’agents envers des fraudeurs.
Marron
Petit objet utilisé par les douaniers lors des longues nuits d’embuscades. Celui qui était de garde devait le tenir dans la main. En cas de contrôle d’un chef, si le douanier était surpris à sommeiller, seul celui en possession du marron était puni. Sa forme exacte est méconnue : caillou, boule ou bâton en bois…?
Mathieu (Saint patron de la douane)
Avant de devenir l’apôtre et évangéliste de la tradition chrétienne connu sous le nom de « Matthieu » (de l’hébreu « Don de Dieu »), le publicain Levi était chargé de collecter les impositions affermées sur le port de Capharnaüm au lac de Tibériade. Si le culte des saints patrons remonte habituellement à la période médiévale, les douaniers et agents du fisc durent attendre le 7 octobre 1957 pour obtenir du Pape Pie XII la ratification de ce patronage, à l’initiative conjointe, en 1953, des douaniers de Bailleul (59) réunis en « Amicale de la Saint Matthieu » et de l’abbé Paul-Auguste Cnapelynck, curé de la paroisse de La Crèche. Depuis lors, le 21 septembre constitue l’occasion pour les douaniers européens de célébrer leur profession et ses valeurs.
Mercure
Dieu romain du commerce identifié à l’hermès grec. Messager des dieux et protégeant aussi les voyageurs, il était représenté coiffé d’un chapeau à larges bords et portant un bâton, le caducée, insigne des hérauts. Ayant voulu un jour séparer avec son bâton deux serpents qui se battaient, ces derniers s’enroulèrent autour de son bâton. Ce dernier symbole a été adopté par de nombreuses douanes du monde et en particulier dans les pays de l’est de l’Europe. On peut ainsi le voir, stylisé dans un écusson, sur les coiffures des douaniers de ces pays. Il a aussi figuré sur la plaque de shako des douaniers français lors de la première restauration. Mercure est également présent sur de nombreux bâtiments douaniers: douane de bordeaux (1730), douane de San Francisco (1900), douane de la havane (1900), douane de Barcelone (1900), douane de madère (1950)…
Minutie
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
Mise en douane
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
Missions spéciales
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
Mitoyen
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
N
Navigation
Applicables aux navires, les droits de navigation ont été recouvrés par l’administration des douanes (d 30/12/1792). Ils comprenaient le droit de francisation, le droit d’expédition, de tonnage, les droits d’acquit, de congé, de passeport, de permis et de certificat.
Noirs (Les noirs)
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
NDP (Nomenclature Des Produits)
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
Non dénommé ni compris ailleurs
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
O
Octroi
Droit acquitté sur certaines marchandises à l’entrée des villes. Ce droit a été supprimé après la seconde guerre mondiale
Origine
L’origine d’une marchandise est l’une des 3 informations essentielles pour son dédouanement. Les autres sont la valeur et l’espèce.L’origine désigne le pays de fabrication. Pour cela des règles précises sont édictées au niveau international afin d’avoir la même définition des opérations qui permettent de conférer l’origine à une marchandise.
Cette définition est particulièrement stratégique car elle impacte les éventuels tarifs préférentiels (par exemple droits de douane réduits ou nuls) et avantages commerciaux conclus entre Etats pour soutenir l’économie locale.
Par exemple en matière textile, le fait de coudre des boutons sur un vêtement n’est pas une opération suffisante pour conférer l’origine de ce pays à la marchandise. En cas de multiplication des pays intervenant dans le processus de fabrication d’un bien, la détermination du pays d’origine peut s’avérer un véritable casse-tête ! Toujours en prenant l’exemple d’un vêtement en coton, la matière première peut venir d’un pays, être tissé dans un autre, la découpe et le montage dans un 3e, puis les finitions dans un 4e, sans oublier que la conception a pu être faite dans une 5e !
P
Paccage (droits de)
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
Pacotille
Acte de petite contrebande exercé par les personnes frontalières, les femmes ou les enfants (pacotilleurs). Terme retenu par l’administration des douanes au XIXe. A l’origine, la pacotille désignait la quantité de marchandises dont les marins et les passagers pouvaient faire commerce pour leur compte. En espagnol « pacotilla » signifie paquet, et provient de paca – ballot. Au XIIIe, elle constituait la marchandise destinée à l’échange et la vente. La notion de vente est passée au second plan pour s’appliquer à des objets quelconques. Le terme est devenu péjoratif au XIXe.
Parts de saisie
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
Passavant
Permis de circulation des marchandises délivré par l’administration
Passeur au clair de lune
Surnom des contrebandiers en Franche-Comté au 18è siècle
Pataccaros
Pratique consistant à faire passer frauduleusement de l’horlogerie suisse en France. Trafic ancien institué par le monopole de la fabrication des horloges, pendules et montres que détenaient les helvètes. Cette pratique est devenue peu courante depuis la seconde moitié du 20è siècle.
Patache
Mot emprunté à l’espagnol « pataje » – navire de guerre léger. Il a pris le sens de « barque au service des douanes » à la fin du XVIIIe. Cette embarcation permettait de surveiller les côtes, de contrôler les navires.
Penthière
Zone de compétence d’une brigade des douanes. Le mot existe depuis l’ancien régime et a été utilisé jusque dans les années 1970. Chaque brigade devait établir la carte de sa penthière. Réalisées à la plume ou à main-levée, quelquefois colorées, certaines représentaient également les animaux ou personnages fréquentant la penthière. Elles étaient généralement divisées en plusieurs parties qui portaient un nom ou numéro de code de façon à dissimuler les lieux d’action du service. Documents stratégiques pour connaître les lieux d’embuscade, elles étaient souvent affichées derrière des volets de bois pouvant être fermés.
Point d’apparition
Voir le mot “apparition”.
Prohibition
Interdiction légale d’importer ou d’exporter certaines marchandises. Le mot prohibé a désigné longtemps l’ensemble des marchandises en cause.
Q
Quarantième
Traduction du latin quadragesime. Droit de 2,5% de la valeur des marchandises perçu par Rome à l’entrée dans ses provinces de gaule.
Quart d’heure chauffeur
C’était le temps de service forfaitaire accordé à l’agent chargé, pendant une vacation mobile, de la conduite du véhicule de service. Il était destiné à compenser le temps consacré à la vérification préalable des niveaux d’eau, d’huile, d’essence, de pression des pneus et de préparation et d’embarquement du matériel de barrage (panneaux “halte douane, herses,..). Institué après la disparition, dans les années 50, des agents spécialistes conducteurs, ce régime a perduré de nombreuses années malgré la fiabilité des automobiles modernes. A noter que la conduite des véhicules de service nécessitait , en plus du permis civil, un “permis administratif” délivré par l’ENBD à la suite d’un examen pratique.
R
Rat de cave
17Ème, les contributions indirectes, outre les droits de douanes, possédaient un service s’occupant uniquement des droits sur les boissons et les vins alcoolisés. Les contrôleurs et inspecteurs, agents mobiles y étaient organisés en « brigade volante ». Cette dernière fouillait et perquisitionnait notamment les établissements, les maisons suspectes. Comme toute bonne fouille débutait par une descente dans la cave, ils furent affublés du surnom de « rat de cave ». Cela se référait également à la bougie utilisée pour descendre dans la cave.
Rayon des douanes
Le rayon comprend toute la zone qui s’étend jusqu’à deux myriamètres, c’est-à-dire jusqu’à 20 kilomètres de la frontière (loi du 8 floréal an XI, art. 84). La zone peut s’étendre jusqu’à 25 kilomètres suivant la topographie (loi du 28 avril 1916). En cas de recherche de marchandises passées en fraude, la distance peut s’étendre à 60 kilomètres à l’intérieur des terres (décret du 28 décembre 1826).
Rayon x
Radiation électromagnétique traversant les corps matériels. Les premières applications douanières remontent à la fin du XIXe siècle (lorgnette humaine). Une expérience a été ainsi conduite en juillet 1897 à la gare saint-Lazare à paris. La fin du XXe siècle a vu se multiplier ces appareils (controllix) pour le contrôle des bagages des voyageurs aériens, puis pour celui des moyens de transport -camions et conteneurs- pour l’exercice des contrôles de sûreté.
Rebat et contre-rebat
Tâches essentielles que le douanier doit effectuer régulièrement. Le rebat constitue une partie du service du matin pendant lequel le douanier recherche avec minutie les traces de passage éventuel des fraudeurs durant la nuit (pierres retournées, herbe dépourvue de rosée, traces de débarquement…). Le contre-rebat est un contrôle effectué par les chefs de poste. Il se pratique sur tout le front de chaque penthière et s’assure de l’exactitude des rebats.
Répartitions
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
S
Saisissant
Agent des douanes constatant une infraction douanière. Il peut saisir tous objets passibles de confiscation.
Sentier des douaniers
Sentier situé principalement le long des côtes, tracé au fil du temps par les douaniers lors de leurs missions de surveillance. Ce sentier a retenu l’attention de nombreux artistes peintres, en particulier à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Ses représentations sont très nombreuses.
Smuggler/smoggleur
Vient de l’anglais, par déformation on utilise un amalgame du français et de l’anglais (le mot se prononce smoggling). Ce courant de fraude était assuré par de petites embarcations montées par des marins anglais. Difficiles à détecter du fait de la petite taille de leurs barques, ils savaient utiliser le brouillard pour accoster. Débutant au XVIIe, ce trafic se fit au détriment de l’Angleterre. Il fut encouragé par les autorités françaises. En 1800, Bonaparte indiquait que « soit favorisé le commerce des smogleurs qui nous est particulièrement avantageux tant par l’importation des laines, et matières premières… » leur trafic s’intensifia pendant le blocus continental (décret du 17 juin 1810). Le port de Gravelines leur était consacré. Cette fraude réglementée constitua une arme économique contre l’Angleterre.
Sous douane
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
T
Tarif
Tableau indiquant le montant des droits de douane. Basé sur la valeur (ad valorem) ou sur les caractéristiques physiques ou techniques (spécifique) des marchandises. Parmi les plus anciens figurent celui de Palmyre et celui d’Alexandrie
THH (être en Travail Hors Heures)
T.H.H. signifie « Travail Hors Heures » – dit aussi T.E.L. pour « travail extra-légal », remplacé depuis par R.T.S. soit « régime de travail supplémentaire » – et fait référence à certaines prestations effectuées par la douane sur demande des usagers et facturées à ces derniers par l’administration.
Titre de transit
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Tonlieu
Droit de tonlieu, impôt prélevé au Moyen Age pour l’étalage des marchandises. Péage sur les marchandises transportées. (ancêtre de l’octroi).
Tontine
Collecte de solidarité lors d’un décès d’un douanier ou d’un membre de sa famille.
Transaction
Mot suggéré par un internaute dans le cadre de l’appel à contributions du 1er septembre 2023 – une définition sera prochainement proposée.
Travailler sur la ligne
Voir définition du mot Ligne.
Travailleur de nuit
Surnom des contrebandiers dans le pays basque, « gauasko » – travail de nuit (voir ramuntcho, pierre loti)
Tuile
Ordre de service établi par le chef de poste à l’intention des préposés
U
V
Valeur
Prix des marchandises et base d’application du tarif des douanes. Afin d’éviter de fausses déclarations en la matière, des commissions des valeurs en douane ont été mises en place au XIXe siècle pour déterminer celles-ci dans de nombreux domaines d’activité.
Valtoutier
nom donné aux douaniers en breton. Il s’agit d’une déformation de « maltôtier », celui qui prélève la maltose, ancien impôt de circulation. Le chemin des douanier se dit donc en breton « hent ar valtouterien » ( cf « Contrebande et surveillance des côtes bretonnes » par Albert Laot – Éditions Coop Breizh)
Vérificateur
Agent des douanes chargé de la vérification des marchandises. Grade de l’administration des douanes au XIXe et XXe siècle. La toute première école des douanes fut celle des vérificateurs créée le 17 mars 1922 dans les locaux de la chambre de commerce de paris.
Visite domiciliaire
Visite de tous lieux même privés où les marchandises ou documents se rapportant à des délits douaniers sont susceptibles d’être détenus.
Volante
Mot (ou expression) proposé(e) par un internaute – une définition sera prochainement proposée.
W
Warrant
Gage ou garantie prise sur une marchandise sans dépossession du débiteur. S’applique en particulier dans le domaine des alcools.
X
Y
Z