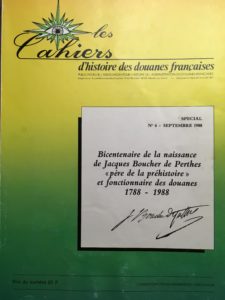Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes
Boucher de Perthes: “Le second et dernier directeur des douanes d’Abbeville” (19)
 Cet article vient clôturer notre cycle dédié, depuis mars dernier, à la carrière douanière de Boucher de Perthes. Avec le récit de son ultime affectation à Abbeville s’achève une série de 19 articles qui lui ont été consacrés. Nous reprendrons bientôt une seconde séquence qui évoquera certains de ses ouvrages, notamment ceux consacrés à l’observation des « moeurs administratives » de son temps.
Cet article vient clôturer notre cycle dédié, depuis mars dernier, à la carrière douanière de Boucher de Perthes. Avec le récit de son ultime affectation à Abbeville s’achève une série de 19 articles qui lui ont été consacrés. Nous reprendrons bientôt une seconde séquence qui évoquera certains de ses ouvrages, notamment ceux consacrés à l’observation des « moeurs administratives » de son temps.
L’équipe de rédaction
Un directeur des douanes parmi d’autres, ou un anachronisme?
Boucher de Perthes est-il représentatif des directeurs des douanes de la première moitié du XIXème siècle ? Cette question appelle une réponse mitigée, en tout cas prudente. Et celà, au motif premier que nous ne possédons pas, sur ses collègues, de sources d’information comparables à Sous Dix Rois. Par ailleurs, sa position à Abbeville présente une originalité marquée si on la compare à celle de la très grande majorité des autres directeurs dans leurs résidences respectives: il s’y trouve, en quelque sorte, dans un fief familial ; les circonstances le mettent, plus que d’autres, en rapport avec les grands de ce monde, tout au moins jusqu’à la Révolution de 1848 ; enfin, le nom qu’il porte, ses alliances et les appuis dont il jouit, lui permettent d’envisager la vie administrative de plus haut et plus librement que ses collègues.
Et on ne peut tout simplement négliger le fait que sa forte personnalité le classe hors du commun.
Ceci étant, Boucher de Perthes n’est pas étranger à son époque et il partage avec d’autres fonctionnaires des douanes de son niveau hiérarchique un certain nombre de caractéristiques. Il n’est pas le seul, loin s’en faut, à cultiver les arts, Ies lettres ou les sciences; ses collègues ont à gérer eux aussi, un nombreux personnel et, en général, ils s’en acquittent comme le directeur d’Abbeville dans un style paternaliste que favorise le caractère semi-militaire des brigades ; les pouvoirs étendus dont ils jouissent favorisent les comportements de type féodal et Boucher de Perthes y incline autant, sinon plus, qu’aucun autre.
Peut-on aller plus loin et exprimer l’idée que le directeur d’Abbeville a dit et écrit ce que ses collègues pensaient sans oser l’extérioriser ? La critique que fait Boucher de Perthes des moeurs administratives reflète certainement, pour partie, des opinions relativement répandues: il en existe des témoignages et on peut relever (l’humour en moins) des concordances entre les thèses exposées par Boucher de Perthes et celles que développera un autre directeur des douanes, Théodore Duverger, dans un ouvrage intitulé La douane française.
Il est beaucoup plus douteux, en revanche, que le libre échangisme ait connu de nombreux adeptes parmi les collègues de l’auteur de l’Opinion de M. Cristophe, tout au moins lors de la parution de cet ouvrage.
Cependant, le temps est proche où un directeur du nom de Bernard Amé (futur directeur général) publiera une étude sur les tarifs douaniers et les traités de commerce favorable à l’abaissement des barrières douanières.
Ainsi, ne doit-on considérer Boucher de Perthes, ni comme un directeur des douanes parmi d’autres, ni comme un personnage anachronique.
Les difficultés d’une succession par primogéniture
De 1826 à 1852, Boucher de Perthes va occuper les fonctions de directeur des douanes à Abbeville.
Ce n’est pas sans difficulté qu’il obtient de succéder à son père dans cet emploi. En dépit des promesses de Louis de Sussy, de Hains, de Lavigerie, etc.. c’est-à-dire de tous les membres du Conseil d’administration, la direction générale des douanes ne semble pas l’avoir beaucoup aidé dans son dessein. Le chef de l’administration, de Castelbajac (avec lequel ses relations sont cependant bonnes), lui fait “sur l’hérédité des places” des objections que Boucher de Perthes estime “assez bizarres” venant “d’une bouche si légitimiste“. Cette observation parait aujourd’hui bien plus bizarre que son objet Mais il est vrai que, dans l’opinion de l’auteur du Petit Glossaire (où le népotisme est dénoncé ), il est normal que “tous les pères (veuillent) jouir de la même faveur pour leurs enfants”.
Boucher de Perthes est convaincu alors qu’on ne lui ferait aucune difficulté s’il n’était pas catalogué comme libéral et s’il avait “voulu être de la congrégation“. Il se peut que son manque d’enthousiasme pour le parti ultra lui vaille quelques inimités, mais c’est néanmoins au très légitimiste marquis de Villèle qu’il doit de triompher finalement des obstacles dressés sur sa route.
Le “directeur de province”
Une fois installé dans ce qui a été si longtemps le cabinet de son père et va devenir le sien pour une aussi longue période, Boucher de Perthes s’estime satisfait.
Il jouit enfin d’une large indépendance; les directeurs de province sont, à l’époque, de petits potentats, bien plus libres que leurs
lointains successeurs vis à vis de l’administration centrale et disposant, en matière de gestion du personnel, de pouvoirs beaucoup plus étendus. Par ailleurs,la circonscription d’Abbeville ne compte pas – on l’a souligné déjà – parmi les plus lourdes, et son responsable peut disposer librement d’une part assez importante de son temps, s’il s’entoure de collaborateurs compétents.
De ce dernier point de vue, Boucher de Perthes a été apparemment favorisé. Doit-on, pour autant, considérer comme une sorte d’autoportrait la définition qu’il donne du “directeur de province“, dans le Petit Glossaire ?
“C’est un homme qui met ses pantoufles le matin et sa robe de chambre, descend au rez-de-chaussée, ouvre la porte et regarde ses commis, puis remonte au coin du feu et attend son déjeuner. A quatre heures, il ote ses pantoufles et sa robe de chambre, descend derechef, s’assied devant une table et signe ce que ses commis ont écrit ou pensé. Le lendemain il recommence et le sur-lendemain encore, et, au bout de trente ans, il a la croix et une pension“.
Cette caricature ne vaut pas pour l’auteur de Sous Dix Rois. D’ailleurs, dans une correspondance adressée à l’un de ses collègues après la parution du Petit Glossaire, il précise sa pensée : les directeurs “auraient beaucoup à travailler s’ils le voulaient, surtout ceux qui dirigent un nombreux personnel” vis à vis duquel ils ont “les devoirs d’un père de famille“.
En 1845, tenté par la retraite, il écrit :”Ce qui me fait hésiter, c’est ce train d’affaires et ce maniement d’hommes auquel je suis habitué depuis tant d’années“.
“Je n’ai jamais failli à mes subordonnés quand ils ont eu besoin de moi “
Quel portrait peut-on brosser de ce directeur des douanes dont on sait par ailleurs l’importance qu’il attache à sa correspondance, à la littérature et à la science ?
Le “train d’affaires” dont il reconnait avoir besoin ne porte guère sur les problèmes de réglementation et d’application du tarif qu’il abandonne sans aucun regret à ses collaborateurs.
Il éprouve en effet peu d’attrait pour ces questions techniques ; il vilipende les “circulaires stupides” et le “code contraire au bon sens“. Quand il s’en mêle, c’est pour atténuer “les formalités inutiles ou tracassières” qui, selon lui, font tort au commerce des ports de la Somme et de la Seine Inférieure. En revanche, deux activités l’intéressent : au premier chef ce qu’il appelle “le maniement d’hommes” ; à un degré moindre, les activités de représentation auxquelles sa position l’oblige.
Le personnel qu’il a en charge est essentiellement composé d’agents des brigades alors fort nombreux le long des côtes. Il aime en observer le comportement ; il y met de l’ironie, mais aussi une évidente sympathie. Il ne lui déplait pas de régler les problèmes mineurs de la vie courante, d’arbitrer, en bref d’exercer le commandement.
De ses obligations de “père de famille“, il a une conception très féodale, fort étrangère à nos conceptions actuelles, mais caractéristique de son époque. Il le manifeste dans les grandes circonstances de la vie administrative, et celles-ci ne manquent pas au cours d’un directorat de plus d’un quart de siècle ponctué de deux révolutions et d’un coup d’Etat.
Lors des bouleversements politiques, Boucher de Perthes a deux soucis en tête : d’une part, s’interposer entre le nouveau pouvoir et son personnel, d’autre part, faire échec aux épurations.
Ainsi, prend-il sur lui, en 1830, d’interdire à ses hommes, sous menace de suspension de fonction, de changer leurs couleurs aussi longtemps qu’il ne leur en aura pas donné l’ordre ; si retard il y a dans l’exécution d’une ordonnance dont il n’a pas reçu “une signification légale et émanant de (ses) chefs directs, seul, dit-il, (il pourra) en être rendu responsable“. Cette attitude met le personnel à l’abri des embarras et des critiques. Comme il fallait s’y attendre, “les dénonciations ne tardent pas à arriver” sur le bureau des nouvelles autorités qui, rapporte Boucher de Perthes, prescrivent “de leur désigner les chefs et les employés contraires au présent état des choses ou (ayant) hésité à s’y soumettre. Je répondis, raconte-t-il, que je me rendais caution pour tous mes subordonnés et que, s’il y avait quelqu’un à destituer, ce ne pourrait être que moi, puisque nul n’avait agi que par mes ordres“.
A deux reprises, en 1848 et en 1851, il adopte une attitude semblable, n’hésitant pas à donner ses ordres par écrit; sous forme de circulaires.
Sa théorie est que le fonctionnaire doit obéissance au gouvernement institué, qu'”il serait absurde, indélicat même de recevoir des appointements d’une main et de frapper de l’autre. et que, si l’on veut conspirer, il convient de donner préalablement sa démission“.
En retour de sa loyauté envers l’Etat, le fonctionnaire doit en obtenir la sécurité. L’hostilité que, dès 1816, il exprime à. l’encontre des épurations politiques, ne fait que se confirmer par la suite. Il dit clairement qu’il ne s’y prêtera pas, si on exige de lui qu’il y mette la main.
II s’agit là pour lui d’une affaire de conscience. C’est le cœur qui parle, en revanche, lorsque les agents ont besoin d’être protégés, non contre le pouvoir, mais contre un fléau naturel comme c’est le cas lors des épidémies de choléra de 1849 et 1852. Il fait preuve alors d’une grande générosité et d’un indéniable courage.
A sa manière, qui est un peu celle du seigneur vis à vis des paysans de ses terres, il aime ses hommes. Et il est fier des compliments que lui vaut, le cas échéant, leur comportement.
Sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet, la situation géographique de la direction des douanes d’Abbeville lui vaut d’être fréquentée, notamment, par les familles royales. La duchesse de Berry a fait de Dieppe une station à la mode. Plus tard, Louis Philippe et les siens seront tous les étés dans leur propriété d’Eu et Fécamp sera le port d’attache du yacht royal. Et c’est au Tréport que la Reine Victoria débarquera lors de sa visite à Louis Philippe. Boucher de Perthes rapporte, avec un plaisir évident, que la tenue des douaniers, “celle des marins surtout qui sont presque tous décorés ou médaillés (a) frappé le Maréchal Soult qui désigna ces derniers pour servir de garde au Roi“, lors de la visite de Louis Philippe à Abbeville, en 1831. Il n’est pas moins satisfait d’écrire plus tard, parlant des séjours de ce monarque à Eu que “(ses) hommes gardent le Roi comme il veut être gardé, c’est-à-dire sans qu’il s’en aperçoive“.
Son jour de gloire est peut-être celui où le roi “témoigne le désir qu’un détachement (de douaniers) en grande tenue et aussi nombreux qu’on pourrait le réunir (soit) au moment du débarquement (de la Reine Victoria, en septembre 1843) placé sur le quai du Tréport, avec tambours et clairons. Je suis parvenu, non sans peine, rapporte fièrement Boucher de Perthes, à réunir un détachement de deux cent dix hommes, dont une compagnie de marins. A leur arrivée, ils ont été passés en revue par (l’) aide de camp du roi, qui les a mis à un poste d’honneur devant la tente royale” ; et de souligner la “belle tenue” du contingent douanier.
Quand, en 1852, sonne l’heure d’une retraite dont les modalités ne lui conviennent pas, Boucher de Perthes a ce trait révélateur : “Je ne regretterai, dit-il, que mon personnel, parce- qu’il m’était fort attaché”.
“Je suis un des grognards de la douane”
Une autre caractéristique de la personnalité de Boucher de Perthes, directeur des douanes, est la grande liberté qui marque ses rapports avec la direction générale.
En 1830, avant que n’éclate la Révolution, il se refuse à se mettre à. la disposition du Préfet, comme il en a reçu l’ordre, pour le seconder à l’occasion des élections. II s’agit bien entendu d’obtenir “bonnes élections“.
Boucher de Perthes déclare au préfet que “la loi ne (lui) conférant point, en (sa) qualité de chef des douanes, le droit d’intervenir dans les élections, tout ce (qu’il pourrait) faire aurait un caractère inofficiel et l’apparence de l’intrigue ; un tel rôle ne peut (lui) convenir“.
Il ne mâche pas ses mots, après les Journées de Juillet, pour dire ce qu’il pense de la réorganisation de l’administration. Il proteste, avec une agressivité dans le ton qui lui est inhabituelle, contre le déclassement dont les directeurs sont alors victimes. La “révolution administrative” qui aboutit alors à la mise à la retraite des anciens administrateurs, à la suppression (temporaire) du poste de directeur général et à la disparition des inspecteurs généraux lui inspire des réflexions défavorables dont il n’hésite pas à faire part à ses correspondants.
Evoquant la nomination aux postes les plus importants de Théodore Gréterin et de quelques chefs de bureau, il écrit que “l’administration (a) plus perdu que gagné en allant chercher si bas ses sommités : partout règnent les médiocrités,” ajoute-t-il.
Les pressions qui s’exercent sur lui pour l’amener à plus de conformisme, le laissent d’une totale indifférence. C’est notamment le cas après la publication de l’Opinion de M. Cristophe : “Ce qui indiquerait combien ces gens-là ont la cervelle étroite, c’est l’émoi que leur ont causé mes innocents articles contre les prohibitions“. Aux représentants de la direction générale qui le “moralisent” à ce sujet, il conseille ironiquement de lire sa prose avant de la critiquer.
D’ailleurs, ajoute-t-il, “il faudra bien qu’ils s’y accoutument car (…) je veux devenir le Chrysostôme administratif”. Par allusion aux vieux soldats auxquels l’Empereur pardonnait leurs récriminations “pourvu qu’ils fissent bien leur métier”, il déclare : “Je suis un des grognards des douanes”. Et quand on lui glisse que son imprudence pourrait avoir de graves conséquences, “qu’il a été agité en conseil si (sa) destitution serait proposée”, il contre-attaque en accusant de violer la loi, ceux qui ont pu envisager une telle hypothèse.
“J’ai eu des chefs qui m’ont aimé…”
“J‘ai eu des chefs qui m’ont aimé, malgré mes velléités d’indépendance… Ils sentaient que ce besoin de liberté n’était pas de l’insubordination ou le désir de me soustraire à leur autorité : c’était le cri d’un cœur convaincu, d’une conscience qui protestait contre ce qui lui paraissait mauvais ou contraire au bien public. Plus d’une fois ils ont applaudi à cette opposition d’ailleurs toujours courtoise, et ont fini par s’y rendre“. Lorsqu’il écrit ces phrases, en octobre 1852, Boucher de Perthes ne songe pas à tous ses anciens chefs, loin s’en faut ; il cite des noms, ceux de Collin de Sussy, de Ferrier, de Hains, de Castelbajac et du météorique directeur général que fut de Villeneuve-Bargemont. Il passe sous silence ceux qui prirent en main les destinées de la douane à la suite de la Révolution de 1830. Il lui était difficile d’éprouver de la sympathie ou de la considération pour des hommes dont la promotion traduisait, selon lui (et selon bien d’autres hauts fonctionnaires de l’époque) le renforcement de la tutelle ministérielle sur l’administration centrale des douanes, donc une perte de prestige. Sans doute eut-il atténué par la suite la sévérité de son jugement si ses idées économiques avaient rencontré, sinon une adhésion franche, tout au moins une certaine compréhension chez les membres du nouveau Conseil d’administration. Mais il n’en fut rien ; un fossé le séparait de ces “gens à courte vue, tout confits des préjugés de la vieille gabelle, dès lors ennemis de toute organisation un peu large, et qui auraient cru la France en péril si on leur eut ôté le privilège des saisies ou le droit de fouiller dans les poches“.
L’agressivité du ton pourrait laisser penser que Boucher de Perthes éprouvait à l’égard de Théodore Gréterin et de ses collaborateurs immédiats une solide inimitié. S’expliquant un jour sur ses relations avec Gréterin, il écrivit : “Je ne lui voulais certainement pas de mal, mais je ne pouvais dire s’il me voulait du bien… (Ses ) opinions, en finances du moins, étaient l’antipode des miennes. Il n’était pas l’ami de la liberté du commerce, tant s’en faut. Mon livre contre les prohibitions était pour lui un véritable contre-sens… Du reste, je lui ai toujours rendu justice : … sa gestion est restée pure. Sans doute on pourrait lui demander plus d’ampleur dans les idées : ses vues financières manquent de portée, mais elles sont consciencieuses… Enfant de la vieille école où il avait conquis tous ses grades, imbu des traditions et des lois du Premier Empire… , il croyait de son devoir de les maintenir, et fidèle à des principes qui avaient été ceux de sa vie entière, il voulait les appliquer avec toutes leurs conséquences“.
“Adieu donc mon bel habit”
Ceux qui ne l’apprécient pas finiront quand même par l’écarter de l’administration avant qu’il n’en exprime lui-même le désir.
L’occasion en sera fournie, en 1852, après la fusion des administrations des douanes et des contributions indirectes qui conduit la direction générale à sortir des cartons un ancien projet de suppression de la direction d’Abbeville. Techniquement, la mesure est justifiée et les protestations abbevilloises n’y peuvent rien. Mieux encore, la fusion administrative dont elle est une conséquence répond à un voeu souvent exprimé, et depuis bien des années, par Boucher de Perthes. S’il qualifie de “demi-mesure” l’opération décidée en décembre 1851, du moins ne la désapprouve-t-il pas et il prend avec humour le surcroît de taches qui lui incombe “depuis qu’on veut faire nos hommes. rats“.
La suppression de sa direction le peine : il l’interprète comme “une petite niche en échange du Petit Glossaire que (l’administration) avait toujours sur le cœur“.
Et puis, la manière dont il est amené à cesser ses fonctions ne lui parait pas honorable : “Il est singulier, écrit-il, qu’entré dans les douanes contre mon gré, c’est aujourd’hui en quelque sorte malgré moi, ou du moins sans m’avoir consulté, qu’on m’en fait sortir“. Le mot – aimable – dont le directeur général accompagne la notification du décret qui le met à la retraite, ne suffit pas à le rasséréner : “Les regrets sont de trop : directeur général et administrateurs n’en éprouvent pas le moins du monde” ; il demeure persuadé qu’ils sont “très enchantés d’avoir trouvé cette occasion de se débarrasser d’un censeur parfois incommode“.
Curieusement, cet homme qui, si souvent, avait par le passé souhaité jouir d’une entière liberté, doit confesser qu’il “n’éprouve pas cette joie de (son) indépendance (qu’il avait) si longtemps rêvée“. Néanmoins, il sort vite de l’incertitude et les adieux qu’il fait à son habit sont le lieu de rencontre du souvenir, de l’émotion, de l’humour, et enfin de la lucidité quant à la précarité de la gloire administrative.
Abbeville, 12 novembre 1852.
A M. ***
Oui, mon cher ami, on vous a dit vrai : me voilà à la retraite, et, d’évêque, devenu meunier. M’en croyez-vous bien désolé ? – Non, je me sens tout guilleret, tout léger, et, comme Frontin, dans la rue, le jour que son maître l’a mis à la porte, je me dis : Enfin, je n’ai plus que moi à servir.
Comme lui aussi, je ne porterai plus la livrée. A bas donc mes broderies et mon beau chapeau à plumes! dormez en paix dans votre armoire, jusqu’à ce que vous alliez parer quelqu’acteur de province qui jouera un rôle de préfet ou de commissaire général.
Peut-être aussi deviendrez-vous la conquête d’un digne enfant de Jacob, acheteur de vieux galons, qui aura reconnu que vous êtes d’argent fin, que vous avez coûté deux cent écus à votre heureux propriétaire, et qu’en vous achetant cent francs comme défroque, il pourra aisément tirer de vous le double en bon métal, car les boutons en sont également, de même que les ganses et la dragonne. oui I honnête israélite, deux cents francs d’argent fin, je vous les promets, et vous aurez le drap en sus pour vous faire un gilet rond ou un caraco à votre petit dernier : c’est donc une bonne affaire que je vous propose.
Peut-être même pourrez-vous la faire meilleure encore. Qui sait si quelque nouveau promu, s’en engouant, ne profitera pas de l’occasion de s’habiller à deux cents pour cent d’économie ? L’habit est bon, quoiqu’il ne soit pas neuf ; c’est que je l’ai mis si peu qu’en vérité on croirait qu’il sort de l’atelier. Aussi je me souviens très bien de ses apparitions au grand jour. Il était fier, mon habit ; il ne se montrait guère que pour les altesses : encore exigeait-il qu’elles fussent royales.
La première fois qu’il sortit de sa boîte, ce fut pour la duchesse de Berri vers l’an 1826 ; la seconde, pour la duchesse d’Angoulême ; la troisième, pour le dauphin ; la quatrième, en 1828, pour le roi Charles X ; et encore en 1829 et 1830, pour ces deux bonnes duchesses.
Grâce à lui, car c’était toujours lui qu’on invitait, nous avons eu l’honneur de déjeuner, dîner, souper avec ces grandeurs.
Après 1830, vous, mon bel habit, n’avez plus vu le jour qu’en 1833 ou 1834 pour le nouveau roi, et chaque année, jusqu’à 1848, vous l’avez revu pour lui, et ce sont là vos jours de gloire.
Depuis ce moment jusqu’aujourd’hui, 12 novembre 1852, vous ne vous êtes montré à personne, et vous ne ferez plus la joie et l’admiration que du fripier et de ses clients. Adieu donc mon bel habit que Dieu vous conserve et vous garde des mites et des tâches !
Quant à moi, je vais prendre la figure de l’état, ou l’air paterne du pensionnaire. Il me reste cinquante jours pour m’y préparer, car ce n’est qu’au 1er janvier 1853 que cessent mes fonctions directoriales. Jusqu’à cette époque, je puis, fermant les yeux, me croire toujours un astre ; mais pour peu que je les entr’ouvre, je vois que mes rayons pâlissent, et que l’astre est sur son déclin. On me salue moins bas, pour s’accoutumer doucement à ne plus me saluer du tout. On vient m’offrir des consolations qui ressemblent à des épigrammes, peut-être parce qu’on s’aperçoit que je n’ai pas besoin d’être consolé, et que cette inhumation précipitée ne m’a pas trop décomposé. “C’est bien cruel pour vous, me dit ce bon ami, à votre âge, plein de force et de santé, être réduit à l’inactivité. Quand on a si longtemps commandé aux hommes, on s’accoutume bien difficilement à l’isolement et à la nullité, et je crains fort que votre santé n’en souffre. Il y a de tristes exemples des conséquences qui en résultent, et je pourrais en citer vingt”.
J’en dispense cet homme obligeant, qui s’en va désolé de ne m’avoir pas vu me plaindre. Eh! bon Dieu ! de quoi me plaindrais-je ? Oui, sans doute, il serait doux de commander aux hommes, si l’on n’était pas commandé à son tour par d’autres hommes qui ne vous traitent pas toujours aussi doucement que vous traitez les autres . Il n’y a ici de différence que dans le numéro ou le rang hiérarchique de l’esclave. Le plus infime des employés commande à quelqu’un : il a son public de parias qu’il mène à sa guise. Il est lui-même le paria de son chef immédiat, qui l’est de dix autres. Moi, directeur commandant à un millier d’individus sur lesquels j’avais presque droit de vie et de mort, puisqu’ils étaient à ma nomination comme à ma révocation, n’étais-je pas le plastron du dernier commis d’un ministre qui, selon son caprice, pouvait me distribuer le blâme et l’éloge, me faire dégrader ou révoquer ?
Mais pourquoi lui en voudrais-je ? Est-il plus sûr que moi de son lendemain ? N’est-il pas à la merci de son chef, comme celui-ci à celle d’un plus gradé, et toujours ainsi jusqu’au ministre lui-même, souffre-douleur du souverain qui, de son côté, l’est du dépouillement d’un scrutin ou d’un caprice populaire ?
De quoi donc me lamenterais-je ? – De n’être plus esclave ? – Quoi ! je puis, avant de mourir, goûter de la liberté, tous les jours avoir congé, sortir et rentrer, veiller ou dormir à mon heure, recevoir qui m’agrée, fermer ma porte à qui m’ennuie, penser, parler, écrire comme il me plait, sans qu’on vienne me fermer la bouche ou briser ma plume, et je me plaindrais ! ! Non, mon cher ami, je ne me plains pas ; et l’on m’offrirait aujourd’hui toutes les places dumonde, fût-ce celle de ministre, que je les refuserais ; et je suis à me demander comment j’ai pu si longtemps porter le bât.
Mais ce n’était pas pour moi que je le portais : c’était pour ces hommes qui tenaient à moi, ces hommes mes compagnons de chaîne. Je restais pour ne pas les abandonner. Puis venait l’habitude, autre nature qui cloue le prisonnier à sa prison, et si bien qu’il n’en veut plus sortir: les exemples n’en sont pas rares.
Vous le voyez : l’habitude tue jusqu’à l’amour de la liberté. Mais, grâce à Dieu ! elle ne l’a pas tué en moi, puisque je me sens heureux d’être libre.
C’est dans six semaines que je jette le froc aux orties. Ah ! que je voudrais que ce fût demain ! Alors je m’écrierai : je reprends ma place au soleil ; à moi l’air ! à moi l’espace!

E. Fort – Directeur des douanes – costume administratif
Cahiers d’histoire des douanes françaises
N° 6 – Septembre 1988 (Numéro spécial)
Bicentenaire de la naissance de Jacques Boucher de Perthes
« père de la préhistoire » et fonctionnaire des douanes (1788-1988)