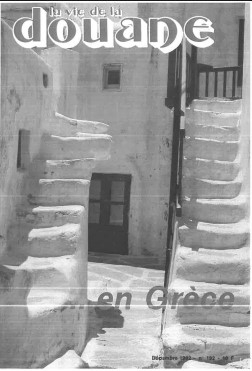Un (bien plus que) centenaire qui se porte bien : Le concours interne
Héritière du «Journal de la formation professionnelle» dont l’un des objectifs originels fut d’aider dans leur préparation les candidats aux concours internes, la Vie de la Douane se doit de commémorer, avant que ne s’achève l’année 1982, le centième anniversaire de ces concours. C’est en 1882, en effet, que s’amorça une réforme, vainement espérée jusqu’alors par des générations de douaniers.
Pour apprécier à sa juste valeur l’importance de l’événement, il faut se remettre en mémoire les conditions dans lesquelles se développaient au XIXe siècle les carrières de nos prédécesseurs.
Comme aujourd’hui encore, en dépit des nombreux changements qu’ont connu ses statuts, le corps des douanes se subdivisait en deux branches : les bureaux et les brigades. A cette époque cependant on n’y pénétrait que par la «petite porte», en débutant aux niveaux les plus modestes de la hiérarchie : celui de commis pour le service sédentaire, et celui de préposé pour le service actif.
La qualité de commis s’acquérait après un surnumérariat d’une durée de deux ans au moins. Les surnuméraires ne percevant aucune rémunération, leurs familles devaient s’engager à assurer leur subsistance jusqu’à ce que la situation des effectifs permette de les «placer», c’est-à-dire de les titulariser dans le grade de commis. Depuis 1829, les surnuméraires étaient recrutés après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen d’aptitude celui-ci permettait de vérifier que les postulants maniaient la plume d’oie d’une «bonne main» et connaissaient l’orthographe ainsi que l’arithmétique. A titre accessoire, on s’assurait qu’ils étaient capables de s’exprimer correctement par écrit.
On leur laissait en outre la faculté de composer dans des matières de leur choix (langues mortes, géographie, langues vivantes, droit, etc…) et de montrer ainsi l’étendue de leur culture générale. Ces dernières épreuves, on l’aura compris, revêtaient un caractère facultatif : l’Administration ne pouvait en effet se montrer trop exigeante, attendu que le destin immédiat des surnuméraires les vouait à effectuer des travaux de copie et qu’une fois titularisés il ne se voyaient confier pendant un laps de temps plus ou moins long que des tâches très subalternes.
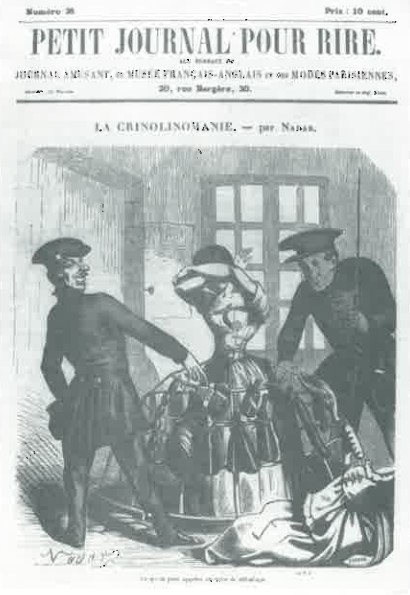 Pour le recrutement des préposés, la procédure était beaucoup plus simple. Comme on exigeait simplement des candidats qu’ils ne soient pas analphabètes (et encore se montrait-on tolérant sur le degré d’alphabétisation quand on tenait, par exemple, à admettre tel fils d’agent ou tel garçon recommandé par un notable), il n’était pas question d’examen; pas d’avantage de surnumérariat, eu égard à l’origine très modeste des recrues. Celles-ci étaient choisies en majeure partie parmi les jeunes gens ayant servi dans l’armée de terre ou la marine. Mais on employait aussi, avant qu’ils aient atteint l’âge normalement requis de 20 ans, des fils d’agents âgés de 18 ans au moins. Dans ce cas la rémunération était limitée à la moitié de la solde normale et les «demi-soldiers» connaissaient cette situation pendant 2 ou 3 ans.
Pour le recrutement des préposés, la procédure était beaucoup plus simple. Comme on exigeait simplement des candidats qu’ils ne soient pas analphabètes (et encore se montrait-on tolérant sur le degré d’alphabétisation quand on tenait, par exemple, à admettre tel fils d’agent ou tel garçon recommandé par un notable), il n’était pas question d’examen; pas d’avantage de surnumérariat, eu égard à l’origine très modeste des recrues. Celles-ci étaient choisies en majeure partie parmi les jeunes gens ayant servi dans l’armée de terre ou la marine. Mais on employait aussi, avant qu’ils aient atteint l’âge normalement requis de 20 ans, des fils d’agents âgés de 18 ans au moins. Dans ce cas la rémunération était limitée à la moitié de la solde normale et les «demi-soldiers» connaissaient cette situation pendant 2 ou 3 ans.
A partir du moment où ils se trouvaient confirmés dans leur emploi, les agents du service des bureaux comme ceux des brigades dépendaient du seul choix de l’administration pour progresser dans l’échelle des rémunérations et des grades. A cet égard, les commis relevaient du Directeur Général. Quant aux préposés, ils étaient tributaires des directeurs régionaux jusqu’au grade de brigadier (équivalent de notre catégorie B), l’accès au grade d’officier (équivalent à notre catégorie A) les rendant eux aussi justiciables de l’administration centrale.
La promotion à la lieutenance constituait une étape très importante dans la carrière des agents des brigades et c’est précisément cette promotion qui a justifié, en 1882, le premier en date des examens d’aptitude à un avancement de grade.
Pour toutes les promotions (de classe ou de grade), l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination n’était jusqu’alors tenue qu’au respect de deux règles : elle ne devait porter son choix que sur des fonctionnaires qui, d’une part, avaient séjourné pendant une durée minimum au niveau hiérarchique immédiatement inférieur, et d’autre part, avaient été inscrits, sur proposition de leurs chefs directs, au «tableau d’avancement». Bien entendu, les commissions paritaires étaient alors inconnues, si bien. que l’Administration n’avait pas à rendre compte de ses choix. Il était dès lors à peu près inévitable que ceux-ci fussent critiqués et, dans un certain nombre de cas, avec juste raison.
De fait, le «favoritisme» et le «népotisme» (pour citer les termes couramment utilisés au XIXe siècle pour caractériser la situation) ont, selon les périodes, plus ou moins pollué la vie administrative. Les critiques ont été particulièrement vives dans les dernières années de la Monarchie de Juillet et sous la Deuxième République. La presse administrative de l’époque fourmille d’accusations portées, sur un ton souvent très agressif, contre le directeur général, Théodore Grèterin et contre les autres membres de l’«aristocratie douanière» à qui l’on reprochait, avec exemples à l’appui de favoriser de manière scandaleuse leurs parents, alliés et autres protégés.
Les attaques ainsi menées se trouvaient en partie fondées, mais il serait aussi injuste d’exagérer l’ampleur du «favoritisme» que d’en nier l’existence : toutes les promotions n’étaient pas dues à la bienveillance imméritée ou à l’intrigue, et ceux qui bénéficiaient de la faveur des autorités n’étaient pas forcément des incapables ! L’important, toutefois, était qu’on pût douter (et légitimement douter) de l’équité de la hiérarchie.
Aussi certains de ses membres souhaitaient-ils depuis longtemps qu’on abandonnât un système discrédité et qu’on recourût aux examens d’aptitude pour former les tableaux d’avancement les plus importants. Dans cette affaire la Douane avait été devancée par plusieurs administrations, notamment par les Domaines, où, depuis les années 50, les concours étaient en honneur.
La «haute administration douanière» se caractérisait même par l’opiniâtreté de sa résistance au changement des gens aussi peu révolutionnaires que Duverger, directeur à Dunkerque et auteur d’un ouvrage intitulé «La Douane française», n’avaient pas réussi à la convaincre de dissiper une lourde équivoque en acceptant l’introduction de l’examen dans les procédures de promotion.
Il faut cependant noter à la décharge de là Direction Générale que les porte-paroles du personnel (aux époques où il y en eut) ne manifestaient pas tous un enthousiasme délirant, lorsqu’était évoquée l’hypothèse d’une sélection fondée sur «le savoir». Ainsi, fa création, en 1848, d’une Ecole d’administration (création au demeurant éphémère) fut loin de susciter l’approbation unanime des fonctionnaires : on craignait qu’en privilégiant la culture on privilégiât aussi les classes aisées dont elle était l’apanage. Duverger, pour sa part, se contentait de proposer que l’accès aux emplois supérieurs (c’est-à-dire au grade de sous-inspecteur qui correspondait au grade actuel d’inspecteur principal) soit subordonné aux résultats d’un examen national.
Il était naturel, selon lui, que l’attention se portât en priorité sur une promotion qui appelait des précautions particulières, compte tenu de l’importance des intérêts en jeu et de l’étroitesse du débouché. Mais on touchait là un domaine réservé et les directeurs généraux n’étaient guère tentés de limiter la liberté de leurs choix.
On ne dit donc pas s’étonner trop de ce que les partisans de l’examen d’aptitude aient réussi plus facilement à se faire entendre à propos de l’accession au grade d’officier.
Ce qui est curieux en revanche, et vaut d’être souligné, c’est que le fait précéda le droit dans la genèse de cette innovation. Que lisons-nous en effet sous la signature du directeur général Ambaud dans la «lettre commune» n° 560 du 17 mars 1882 qui constitue l’acte de naissance officiel des concours internes ?
«Les tableaux d’avancement établis par les Inspecteurs ne présentent pas toujours des indications suffisamment précises pour permettre aux Directeurs et à l’Administration de se rendre un compte exact du degré relatif d’instruction des brigadiers proposés pour la lieutenance. Aussi l’usage s’est-il introduit, dans certaines Directions, de faire subir un examen à ces agents avant d’admettre leur candidature.
Partout où la mesure a été appliquée, elle a été bien accueillie par le personnel, et elle a donné de bons résultats. Désireuse de n’appeler à la position d’officier que des sujets réellement méritants, et d’observer dans les choix la plus stricte impartialité, l’Administration a pensé qu’il y avait lieu de généraliser ces concours. Elle a, à cet effet, arrêté les dispositions suivantes :
«Seront seuls admis à concourir les brigadiers âgés de moins de 40 ans et portés tout à la fois par leur Inspecteur et par leur Directeur au tableau d’avancement. Toutefois, afin de ne pas priver du bénéfice de leur présentation les brigadiers plus âgés qui figurent actuellement au tableau, on les admettra, cette année et par exception, à subir les épreuves.
«Les candidats pourvus du brevet d’officier de réserve seront dispensés du concours. La même dispense s’appliquera aux candidats munis du diplôme de bachelier ou de celui d’instituteur; seulement, ils auront à justifier devant la Commission de leur instruction militaire. Les agents de ces trois catégories, qui réuniront les conditions requises, seront inscrits en tête de la liste de classement, dans l’ordre suivant : officiers de réserve, bacheliers, instituteurs.
«Le concours aura lieu au chef-lieu de chaque direction; la date en sera fixée par l’Administration. Le programme, uniforme pour toutes les Directions, sera transmis à MM. les Directeurs, sous plis cachetés qui seront ouverts seulement en présence des candidats.
Il comprendra :
Une dictée;
Une page d’écriture à main posée;
Quelques questions de géographie générale:
Quelques problèmes ou questions d’arithmétique élémentaire;
Un rapport sur un Sujet de service;
La rédaction d’un procès-verbal, au point de vue des règles légales à observer;
Des questions sur la théorie militaire.
«La Commission d’examen sera composée du Directeur, président, des Inspecteurs ou Sous-inspecteurs divisionnaires, et d’un capitaine par inspection. Les Capitaines seront désignés par le Directeur et choisis parmi ceux dont j’instruction militaire est le plus avancée. Les Sous-Inspecteurs chefs de bataillon feront également partie de la Commission, alors même qu’ils ne seraient pas divisionnaires.
«Après révision des épreuves, la Commission arrêtera une liste de classement. Ses délibérations seront prises à la majorité des voix. «Toutes ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal, qui sera transmis à l’Administration avec les épreuves des candidats.
«On y joindra, en outre, une copie de la feuille de services et des notes périodiquement données par les Inspecteurs et les Capitaines, ainsi qu’un double de la feuille de punitions et un relevé des éloges, témoignages de satisfaction, récompenses, que l’agent a mérités au cours de sa carrière. Ces dernières pièces seront également fournies pour les candidats dispensés de l’examen; mais, pour ces agents, on se bornera à indiquer, sur la formule récapitulative, le motif de la dispense, en produisant à l’appui une copie certifiée du brevet ou du diplôme.
 «Dès la réception des procès-verbaux d’examen, l’Administration procèdera à une révision générale des compositions; puis, après s’être rendu compte de la valeur relative des candidats au point de vue de l’instruction, et s’être formé par un examen attentif des états de service, des notes, du relevé des récompenses et des feuilles de punitions, une opinion sur leurs qualités professionnelles (culture générale, caractère, éducation, tenue, esprit de commandement, connaissance du service, etc. etc.), qualité, qui ont une importance capitale, elle arrêtera un double classement : l’un spécial à chaque Direction, comprenant tout à la fois les candidats disposés à accepter leur promotion partout et ceux qui la limitent à une région déterminée; l’autre, d’ensemble, pour tous les candidats qui auront déclaré se mettre à sa disposition. Les Directeurs, dans leurs propositions de mutations, se conformeront rigoureusement à ce classement…
«Dès la réception des procès-verbaux d’examen, l’Administration procèdera à une révision générale des compositions; puis, après s’être rendu compte de la valeur relative des candidats au point de vue de l’instruction, et s’être formé par un examen attentif des états de service, des notes, du relevé des récompenses et des feuilles de punitions, une opinion sur leurs qualités professionnelles (culture générale, caractère, éducation, tenue, esprit de commandement, connaissance du service, etc. etc.), qualité, qui ont une importance capitale, elle arrêtera un double classement : l’un spécial à chaque Direction, comprenant tout à la fois les candidats disposés à accepter leur promotion partout et ceux qui la limitent à une région déterminée; l’autre, d’ensemble, pour tous les candidats qui auront déclaré se mettre à sa disposition. Les Directeurs, dans leurs propositions de mutations, se conformeront rigoureusement à ce classement…
«Les dispositions générales qui précèdent n’auront qu’un caractère provisoire. Après un essai suffisant, et lorsqu’on aura pu juger des résultats produits, elles recevront les modifications qu’indiquera l’expérience, et feront alors l’objet d’un règlement».
Il fallut deux années pour que la direction générale tire les conclusions de cette expérience : une circulaire de 1696 du 12 décembre 1884 nous apprend que «les Directeurs ont été d’accord pour demander le maintien du concours», car «la mesure avait été accueillie avec satisfaction par le personnel, qui y (vit) des garanties sérieuses d’impartialité», et, de surcroît, elle avait eu «pour conséquence immédiate d’exciter l’émulation parmi les sous-officiers, de les encourager à travailler à leur instruction».
Devant une telle unanimité, l’Administration ne pouvait que confirmer le recours à l’examen. Elle le fit en apportant cependant de légères retouches au dispositif de 1882 : ainsi noterait-on désormais de 0 à 10 (au lieu de 0 à 5) pour «faire la part des nuances entre les compositions d’une valeur à peu près égale». Un deuxième concours (le terme est cette fois officiellement employé) put ainsi avoir lieu le 9 avril 1885.
On voit que la pratique des compétitions régulières permettant de couvrir les besoins d’une année restait encore à découvrir. Et de fait, il fallut attendre 1888 pour qu’ait lieu un troisième concours de la lieutenance.
Entre temps cependant on avait beaucoup réfléchi sur le sujet et des dispositions nouvelles avaient été arrêtées. Et tout d’abord, étant donné «les nombreuses garanties qu’offrait ce mode de recrutement, dont la valeur et l’équité ne (faisaient) plus doute pour personne», on avait décidé d’étendre le système du concours au recrutement des sous-inspecteurs.
Le changement de doctrine était à cet égard spectaculaire. Ne reconnaissait-on pas, en effet, que la méthode jusqu’alors suivie n’offrait que «des indications insuffisantes pour apprécier sûrement la valeur morale et professionnelle des candidats» ? N’affirmait-on pas en outre, que le recours à l’examen d’aptitude «faciliterait…au mérite personnel les moyens de se mettre en lumière sans autre aide que ses propres forces, comme il convient dans une démocratie bien ordonnée» ?
Autre innovation intéressante :
L’«examen d’aptitude pour le grade de sous-inspecteur» a été, d’entrée de jeu, national, c’est-à-dire apprécié par un jury unique; il a aussi comporté dès la première fois, des épreuves écrites (soumises au Jury sous couvert de l’anonymat) et des épreuves orales réservées aux candidats déclarés «admissibles».
Par ailleurs, on jugea opportun en 1887 de faire une place très large au «mérite professionnel», cette orientation valant aussi bien pour l’inspection que pour la lieutenance. Dans le premier cas, on avait affaire à des fonctionnaires ayant déjà fait la preuve d’une formation générale suffisante : aussi estimait-on pouvoir se contenter de les soumettre à des épreuves professionnelles; dans le second cas, l’impasse ne pouvait être faite sur la vérification des connaissances de base, mais on y ajouta des épreuves professionnelles : rédaction de rapports de service et de procès-Verbaux.
En outre, on introduisit, dans les deux examens, une «cote numérique d’ensemble» de 0 à 20 présentant l’opinion des chefs de service sur les «aptitudes spéciales», du candidat au grade postulé.
A cette appréciation chiffrée, péjorativement connue sous l’appellation de «cote d’amour», était censé correspondre tout ce que ne permettait pas de saisir l’examen proprement dit, c’est-à-dire des éléments tels que «l’attitude et le caractère, la tenue et la représentation, l’esprit de discipline, la capacité professionnelle et l’aptitude au commandement».
Ainsi se trouvèrent définies les bases d’un système de promotion interne qui allait connaître une remarquable longévité.
Les deux concours de la lieutenance et de l’inspection une fois organisés, les obstacles les plus sérieux à l’extension des examens de promotion étaient vaincus et il était inévitable que, tôt ou tard, d’autres avancements y soient subordonnés. Effectivement, les nominations aux grades de sous-brigadier et de brigadier, dans le service des brigades, puis à celui de vérificateur, dans le service des bureaux, ne purent s’obtenir, à partir de 1900, que par la voie des concours.
Cette évocation d’un passé déjà lointain serait incomplète si deux observations ne venaient pas la conclure.
La première porte sur la préparation des agents aux examens professionnels qui a fourni à la solidarité douanière l’occasion de manifester sa réalité. On le vit sur le terrain, et dès l’origine, quand les chefs du service actif se transformèrent spontanément en «instituteurs» pour aider les postulants à se hausser au niveau requis. On le constata aussi, au tout début du XX» siècle, quand «le Douanier», organe des associations d’agents des brigades (les syndicats de fonctionnaires n’étant pas encore autorisés), mit au point fa première préparation par correspondance.
La seconde observation se veut plus «philosophique». A une longue période durant laquelle l’avancement avait lieu exclusivement au choix a succédé une autre période marquée par la primauté des concours. Le concours reste aujourd’hui la voie d’accès la plus large à la plupart des grades, mais le choix est redevenu un mode de promotion parallèlement admis par tous les statuts particuliers des fonctionnaires de la direction générale des Douanes et droits indirects. Vanité des choses humaines ? Ou synthèse heureuse ?
Les deux ensemble, sans doute.
Jean Clinquart
(Directeur Interrégional à Paris )
La vie de la Douane
N° 192
Décembre 1982