L’Administration des douanes sous l’Empire : réflexions

La politique douanière du Consulat et de l’Empire dominée par le blocus visant les marchandises anglaises s’est traduite par des mesures violentes que la douane s’est efforcée d’appliquer. Les directeurs généraux, Collin de Sussy puis Ferrier, ont sans cesse, par la menace et les récompenses, mis tout en œuvre pour faire de la Douane une arme économique servie par des préposés qu’ils voulaient zélés et dévoués.
 La réputation de ces grands commis de l’État n’a pas été entachée de soupçons de prévarication et il en a été de même pour les directeurs régionaux, à l’exception notable du directeur de Strasbourg. Ils ont lutté contre la corruption et ont châtié les agents qui ont succombé à la tentation de l’argent facile. Ils surent faire comprendre à la grande majorité l’importance des deux grandes missions de la douane, la perception des droits et la lutte contre la fraude.
La réputation de ces grands commis de l’État n’a pas été entachée de soupçons de prévarication et il en a été de même pour les directeurs régionaux, à l’exception notable du directeur de Strasbourg. Ils ont lutté contre la corruption et ont châtié les agents qui ont succombé à la tentation de l’argent facile. Ils surent faire comprendre à la grande majorité l’importance des deux grandes missions de la douane, la perception des droits et la lutte contre la fraude.
Sur le plan fiscal, les mesures protectionnistes et prohibitionnistes ont amené une réduction sensible des recettes purement douanières compensée par les rentrées satisfaisantes du droit sur le sel. Collin et Ferrier se sont attachés à choisir et à motiver les directeurs provinciaux et les agents d’encadrement et leur ont donné la possibilité de montrer des qualités d’organisation et d’aptitude à l’action. Il leur a fallu résister aux pressions des autorités politiques, administratives, judiciaires et militaires pour garder à la douane toute l’indépendance nécessaire.
Les agents des douanes, à tous les échelons, ont vécu pleinement les événements militaires, ils ont suivi et souvent accompagné les troupes dans leurs conquêtes et, plus tard, dans leurs replis successifs. Quand la situation l’a imposé, et tout en tâchant de garder un minimum de cohésion aux lignes de douane, ils ont su apporter leur concours à la défense de l’Empire et ont fait preuve d’une détermination et d’un courage unanimement reconnus.
La douane est très appréciée de Napoléon qui la défend contre son entourage. C’est ainsi que, le 20 septembre 1810, il écrit à Charles Lebrun, son lieutenant général en Hollande, après l’abdication du roi Louis Bonaparte : « Je suis loin d’approuver votre conduite. Avez-vous bien fait de faire arrêter un douanier qui a été blessé en faisant son devoir? Il faut partir de ce principe que les douaniers doivent être soutenus. Il serait affreux pour les hommes et déshonorant pour l’administration qu’elle les abandonnât ».
La Douane s’est montrée le plus souvent à la hauteur de sa mission. Les douaniers, n’ont pas été sans reproche et n’ont pas toujours su résister à la corruption, très vivace dans le milieu où ils ont évolué. Cependant, dans l’ensemble, ils ont su faire preuve de discipline et de dévouement dans une situation réglementaire et tarifaire en constante évolution, au contact avec une population généralement hostile et confrontés à une mobilité des lignes de douane génératrice de difficultés constantes ainsi qu’à une contrebande très organisée, inventive, agressive et sans cesse croissante.
Jean Clinquart, évoquant le problème de la corruption, affirme : « II faut se garder cependant de l’erreur grave qui consisterait à oublier que les douaniers demeurèrent avant tout des douaniers appelés à déjouer les « ruses de la contrebande ».
Faisons nôtre sa conclusion : « Et si ce temps favorisa certaines turpitudes, il fut surtout, aux niveaux les plus élevés de l’Administration, le temps du labeur et de la rigueur dans la gestion et, à des niveaux plus modestes, celui de la discipline et du dévouement. C’est alors aussi que l’ensemble du corps des douanes prit conscience de l’importance de sa mission.
Il est vrai que l’administration douanière y vit sa place dans l’État, ses pouvoirs légaux et ses moyens portés à un niveau exceptionnellement -anormalement- élevé. Plus qu’aucun autre service public, elle vécut, au plein sens de l’expression, l’époque impériale. À peine est-il excessif d’affirmer que ses brigades constituèrent, dans la stratégie napoléonienne, une armée parallèle, associée aux forces militaires dont il leur arriva de partager les souffrances, sinon les lauriers, mais plus spécialement engagée dans une bataille économique, toujours impopulaire et jamais gagnée.
De tout cela : souvenirs et fierté partagés, usages et langage communs, structures et méthodes éprouvées, procèdent des traditions et d’un esprit de corps qui se sont en grande partie perpétués jusqu’à nos jours, en dépit des changements de régime, des guerres et des réformes ». « Et ce n’est point chose négligeable ».
Sources principales :
—Jean Clinquart
L’Administration des Douanes en France sous le Consulat et l’Empire. Juridictions d’exception en matière douanière sous le Premier Empire. Origine et ambiguïté de la création du corps militaire des Douanes au XIX’ siècle.
Documentation et photothèque du Musée des Douanes de Bordeaux.
— Bibliothèque de l’École Nationale des Douanes Collection des lois et règlements des douanes. Les Annales des Douanes
— Journal de la formation professionnelle
—La Vie de la Douane
— Th. Duverger : La Douane Française.
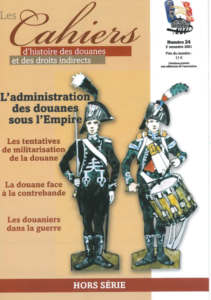
Cahiers d’histoire des douanes et droits indirects
Hors série N° 24
2e semestre 2001
