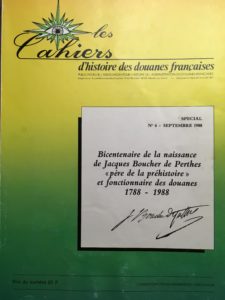Boucher de Perthes en Italie: quelques figures marquantes… (9)
Le chat de la douane de Gênes
“Il y avait à la douane un chat destiné à défendre contre des souris très voraces en ce pays, les papiers administratifs et autres propriétés du domaine mais, comme ce chat ne pouvait pas manger que des souris et qu’il lui fallait au moins un peu de lait pour se rafraîchir, on fai- sait, tous les trimestres un état intitulé : dépenses du chat, qu’on envoyait à l’administration! Le directeur proposa de lui accorder un petit traitement proportionné à sa taille et à ses fonctions; mais l’administration répondit, par des raisons fort claires et très bien déduites, qu’on pouvait à la rigueur se passer de chat ; que des boulettes devaient suffire, et elle en envoya la recette.

On continua pourtant, par humanité ou par respect pour les droits acquis, à nourrir le chat aux dépens de l’Etat. Mais en ce moment, il y a vacance: la pauvre bête est morte dans l’exercice de son emploi, probablement en voulant essayer si la recette administrative était bonne et si les boulettes destinées aux souris étaient efficaces.
On propose aujourd’hui de le faire remplacer par un surnuméraire”.
J. Boucher de Perthes (Sous dix rois)
Le tambour des douanes
 Depuis 1800, les agents des douanes portent pour uniforme I’« l’habit de drap vert »qui caractérisera cette administration pendant de longues années. Tous les agents, sans exception, étaient, en principe, astreints au port de cette tenue. Dans l’ancienne France, il semble que cette obligation n’ait pas été immédiatement respectée, en particulier par les agents des bureaux. En revanche, dans les pays conquis, c’est-à-dire là où la douane vivait au contact permanent de l’armée, le port de l’uniforme semble normal et même indispensable.
Depuis 1800, les agents des douanes portent pour uniforme I’« l’habit de drap vert »qui caractérisera cette administration pendant de longues années. Tous les agents, sans exception, étaient, en principe, astreints au port de cette tenue. Dans l’ancienne France, il semble que cette obligation n’ait pas été immédiatement respectée, en particulier par les agents des bureaux. En revanche, dans les pays conquis, c’est-à-dire là où la douane vivait au contact permanent de l’armée, le port de l’uniforme semble normal et même indispensable.
L’iconographie nous révèle que, dans le silence des textes administratifs, douaniers à pied comme doua- niers à cheval, se référant aux pratiques alors suivies dans les corps de troupe, sacrifièrent à la mode des uniformes rutilants et de la compétition vestimentaire entre armes et unités. On a vu Brack sacrifier immodérément sans doute, à sa prédilection pour la «belle tenue».
Les brigades avaient alors, sinon leurs musiques, du moins des tambours. Ceux de Gênes, raconte Boucher de Perthes, étaient réputés ; ils étaient très recherchés pour accompagner les processions et cette activité marginale leur permettait un substantiel arrondissement de leur paye.
«La musique militaire … est la plus recherchée, et, conséquemment la mieux rétribuée. Nos musiciens de régiment ne tarissent pas sur l’utilité des processions ; on se les dispute, on se les arrache, et on les paie à tout prix. Il n’y a pas jusqu’au plus petit fifre qui ne trouve à se placer. La vogue des tambours n’est pas moins gran- de : ceux des douaniers, qui passent pour les meil- leurs de la garnison, peuvent gagner en un jour autant que leur paie d’un mois ; aussi faut-il voir comme ils sont devenus dévots!».
Un inspecteur original : l’inspecteur Leleu, chef de la ligne spéciale des Alpes
 En 1806, les lignes de douane installées en Italie ne paraissant pas suffisamment imperméables, il fut décidé d’établir ou de rétablir entre Nice et le Valais «une ligne de brigades chargée d’empêcher la contrebande et de recueillir des renseignements sur la direction que prendra le commerce réciproque entre la France et l’Italie».
En 1806, les lignes de douane installées en Italie ne paraissant pas suffisamment imperméables, il fut décidé d’établir ou de rétablir entre Nice et le Valais «une ligne de brigades chargée d’empêcher la contrebande et de recueillir des renseignements sur la direction que prendra le commerce réciproque entre la France et l’Italie».
Constitué en inspection indépendante ce service fut confié à un homme que Boucher de Perthes avait connu dans la direction d’Abbeville, au tout début de sa carrière. M. Leleu était un personnage original, « très bon chef de brigade, infatigable, brave jusqu’à la témérité», et sans doute est-ce à ces qualités qu’il dut d’être nommé à un poste difficile. Ce n’était pas, en tout cas, un homme du monde, mais « sa franche originalité, ses saillies bizarre sans être grossières faisaient oublier, rapporte Boucher de Perthes, sa lourde et épaisse enveloppe ».
Une anecdote peint admirablement le personnage. « Un inspecteur général étant en mission (à Dieppe) y fut magnifiquement traité par toutes les autorités et notamment, selon l’usage d’alors, par les fonctionnaires qu’il venait vérifier. Le sous-inspecteur Leleu était de tous les repas, ne mangeant, d’ailleurs, que les mets les plus simples, car il était fort sobre.
Quelques temps avant le jour fixé pour le départ de cet officier supérieur, il va, à son tour, lui faire son invitation qui est acceptée. C’était un déjeuner. L’inspecteur général se rend, à l’heure dite, au logis du sous-inpecteur. Il n’y avait aucun préparatif, pas un couvert mis. Il croit être arrivé trop tôt. Mais Leleu le détrompe : il lui dit qu’il a voulu le faire déjeûner à la façon du douanier en embuscade. Là-dessus, il le conduit dans son jardin, le fait descendre dans un trou qu’il avait fait creuser pour la circonstance, et sur le bord duquel étaient posés deux oignons crus, un plat d’oeufs durs et du pain. Il offre un oignon à son invité, et prend l’autre. Il lui présente ensuite des oeufs durs, et sort une fiole de sa poche, il verse sur les oeufs la sauce qu’elle contenait: c’était de l’huile et du vinaigre mêlés de sel et de poivre; sauce, disat-il, sans laquelle il ne marchait jamais, parce qu’elle était bonne pour tout et avec tout.
L’inspecteur général était M. Laugier, depuis directeur à Valenciennes, et homme d’esprit. Il ne se fâcha pas de l’épigramme, car c’en était une, mangea l’oignon et les oeufs, trouva la sauce excellente, but par-dessus un verre d’eau-de-vie, et remercia M. Leleu de son bon accueil. Celui-ci fut sans doute fort satisfait du compliment, car peu de temps après, il donna une fête du même genre quoiqu’un peu mieux fournie de vivres, à un chef de bureau du ministère ».
L’originalité de ce brave homme était-elle la marque d’un esprit quelque peu dérangé ? Toujours est-il que « devenu fou » aux dires de Boucher de Perthes, l’inspecteur Leleu dut être mis à la retraite d’office en 1808.
La banque Saint-Georges

“La douane ressemble à une église ; tout autour sont des niches et de grandes figures de pierre sous lesquelles travaillent les employés, le dos au mur. Le milieu reste vide et abandonné au public : c’est une sorte de promenade couverte où marchands, commis, moines et abbés circulent pêle-mêle”.
(Sous Dix Rois)
C’est une forte curieuse institution que la compagnie génoise de Saint-Georges que Boucher de Perthes appelle, comme ses contemporains, la Banque de Saint- Georges. Cette compagnie s’est formée à Gênes au tout début du XV’ siècle. Elle en devint rapidement la principale institution.
Il s’agissait du regroupement d’associations de financiers (les COMPERE) auxquelles, au fur et à mesure des besoins de la Trésorerie, la cité avait concédé divers impôts en contrepartie de prêts. Chaque COMPERA disposait ainsi, pendant un laps de temps déterminé, d’une gabelle dont le rendement était en rapport avec l’importance de l’emprunt couvert par les membres de la COMPERA. Ces opérations s’étant multipliées au fil des années, l’Etat génois connaissait une situation financière des plus confuses : non seulement les stipulations des contrats qui le liaient aux COMPERE étaient plus ou moins avantageuses pour l’une ou l’autre des parties, mais il avait souvent fallu créer des gabelles en rapport avec l’importance des appels de fonds successifs. Ainsi répondait à la multiplication des emprunts un fractionnement de plus en plus poussé de la fiscalité sous la forme de gabelles à champ d’application restreint.
La concentration des COMPERE au sein de la Compagnie San Giorgio a répondu à la nécessité de cla- rifier l’imbroglio. Il a fallu plus d’un demi-siècle pour réaliser l’opération, Vers le milieu du XV’ siècle, en tout cas, la Banco di San Giorgio s’était rendue maîtresse de la totalité des gabelles. Elle disposait notamment des douanes (CARATI MARIS et droits accessoires) dont le produit représentait le tiers de ses revenus. C’est alors qu’elle établit son siège au Palais de la Mer qui devint le Palazzo San Giorgio. Le bureau de la douane y était installé depuis longtemps.
Les actionnaires de San Giorgio, c’est-à-dire les COMPERE, appartenaient pour moitié environ à la clas- se aristocratique {NOBILI) et pour l’autre moitié à la classe bourgeoise (POPOLARI). Des ententes durables se formèrent entre COMPERE au sein de chaque classe ; ces ententes ou ALBERGHI permirent la poursuite d’objectifs communs, par exemple la prise en charge totale de l’administration et de l’exploitation de «colonies» génoises comme l’île de Chio.
La compagnie n’assurait pas directement la perception des gabelles. Elle avait le droit de les affermer. Pour le douanes, cet affermage se négocia d’abord annuellement, mais cette manière de faire comportait de graves inconvénients : la précarité de leur situation interdisant aux fermiers de se donner les moyens d’une collecte efficace de l’impôt, la fraude était considérable ; de surcroît, à l’approche de la fin du bail, le nouveau fermier « achetait » les armateurs et capitaines de navires afin qu’ils différent leur entrée dans les ports gênais ainsi que le dépôt de leurs déclarations jusqu’à échéan- ce du bail en cours.
Quand les Français annexèrent Gênes la Banque Saint-Georges existait toujours ; elle avait donc quatre siècles (1). Toutefois, Gênes souffrait alors depuis plusieurs années des conséquences du blocus anglais. La déliquescence de la situation économique et la perte d’autorité de l’oligarchie jusqu’alors dominante avaient provoqué la fuite des capitaux. La Banque St-Georges avait cessé de pourvoir aux besoins du Trésor public. La vieille institution génoise vivait dès lors ses derniers moments. C’est une simple survivance d’un passé révolu que les Français mirent à bas, après avoir posé en principe que désormais les avoirs des particuliers ne pourraient en aucun cas se substituer au trésor public.
“Voici les dimensions de la grande salle de la douane de Gênes, telles que j’ai pu les prendre à vue d’œil: quarante et un pas de longueur, vingt-quatre de largeur, et environ 26 de hauteur. Mes pas sont à peu près de deux pieds. Le bâtiment de la douane est celui de l’ancienne Banque St-Georges ».
Sous Dix Rois
(1) Pour en savoir plus, Jacques Heers, Gênes au XV’ siècle, Seuil, Paris, 1971
Emmanuel Dobsen et sa turbulente épouse
Emmanuel Dobsen que son signalement administratif désigne sous le nom d’Emmanuel d’Obsen de la Bretonnière a occupé à Gênes le poste d’inspecteur avant d’être nommé directeur à Foligno. Il est de près de dix ans l’aîné de Boucher de Perthes qui se dit son « cousin », en raison d’une parenté commune avec la famille de Hante.
Dobsen ou d’Obsen est né à Soissons en 1769. Son père Claude Emmanuel est alors avocat en cette ville et il va connaître, à la faveur de la Révolution, un curieux destin. Désigné comme député suppléant du Tiers aux Etats généraux, il ne siège pas à l’Assemblée Constituante, mais il est élu administrateur de la Marne en 1790, puis juge à Epernay l’année suivante. Il s’inscrit aux Jacobins, monte à Paris où il acquiert une notoriété suffisante dans la sans-culotterie parisienne pour être nommé, en 1792, président du 6e tribunal criminel provisoire (quartier Notre-Dame). Sa position s’affirme encore après le 10 août puisqu’il dirige alors le jury d’accusation du Tribunal criminel extraordinaire, connu sous le nom de Tribunal du 10 août. Il rentre ensuite dans le rang et occupe un poste de commissaire national près le Tribunal Civil du 6e arrondissement. Il joue alors un rôle discret, mais efficace aux côtés de Robespierre : il est le fomentateur de troubles populaires au début de 1793, l’organisateur de l’insurrection du 31 mai qui aboutit à l’élimination des Girondins; il met en place et anime le comité qui noyaute la Commune de Paris. En août 1793, il siège comme juge au Tribunal révolutionnaire. Il s’en fait toutefois éliminer moins d’un an plus tard en raison de sa mollesse et de sa propension à sauver la vie de ses parents et amis.
Fidèle néanmoins à Robespierre, il tente de lui venir en aide le 9 thermidor. Cette attitude aurait pu lui coûter cher, mais son éviction du Tribunal révolutionnaire (éviction dont les causes sont connues) le sauve et lui permet même de devenir, après les événements de Thermidor, le président de ce Tribunal. Mais la guillotine n’a décidément pas ses faveurs; il recommence à protéger des accusés, si bien qu’on l’élimine une seconde fois. Il redevient activiste, se trouve à l’origine de l’émeute du 12 germinal, est arrêté, puis amnistié quand la Convention se sépare. Il n’est pas guéri pour autant : co-fondateur du Club du Manège, il complote avec Babeuf et manque d’y laisser sa tête. Sous le Consulat, cette fois assagi, il est nommé Procureur général à Trêves. En 1811, il est mis à la retraite. Il a alors 68 ans (I ).
Son fils Emmanuel fait une carrière militaire : chef de bataillon à 27 ans, il quitte néanmoins l’armée pour entrer dans les douanes. Après un bref séjour à la direction générale, il sert à Luxembourg, à Martigues, à Ajaccio (où il séjourne 2 ans et se serait lié à la famille de Bonaparte). En 1800, on le retrouve à Mayence avec le grade de contrôleur de brigades; il est donc passé du service sédentaire dans le service actif, mais cette expérience est de courte durée, puisqu’un an plus tard, il exerce les fonctions de sous-inspecteur à Clèves. Six ans après son entrée clans la douane, il obtient le grade d’inspecteur aux Sables d’OIonne; à l’évidence, de bonnes fées veillent sur lui ! Son séjour sur la côte atlantique est très court. Quelques mois se passent et il fait ses malles pour l’Italie. De Mondovi, il est affecté à Gênes comme inspecteur principal. Nous sommes en 1808.
A Gênes, la Douane est placée comme l’on sait sous l’autorité de Charles Brack, qui mène une vie mondaine à laquelle se trouvent associés ses collaborateurs les plus proches. Les membres de la bonne société génoise, du moins ceux qui appartiennent au parti français sont reçus chez Brack et eux-mêmes reçoivent beaucoup. C’est ainsi que d’Obsen fait la connaissance du signor Saetoni, l’un des chefs du parti français et riche négociant ; il approche par la même occasion Marina Seatoni, l’une des filles de ce notable, 17 ans et demi, « bien jolie quoique petite », «vive, charmante, pétillante d’esprit », « l’une des plus charmantes de Gênes ». Cette jeune personne séduit d’Obsen qui en tombe éperdument amoureux, et l’épouse. Elevée dans un luxe princier, la petite Madame d’Obsen défraie la chronique génoise par son espièglerie. Boucher de Perthes se fait un plaisir de raconter dans ses lettres à ses parents quelques exploits de sa « folle », de son « endiablée » de cousine. Nous ignorons si Mme d’Obsen s’est assagie par la suite. En 1812, son mari est nommé directeur à Foligno où il reste en poste jusqu’à l’évacuation de l’Italie. A son retour dans l’ancienne France, il connaît (brièvement) le sort de tous les fonctionnaires des départements des pays conquis : il se trouve sans emploi, car, à l’époque, aucun statut ne protège les fonctionnaires.
Plus heureux que d’autres, d’Obsen est réintégré assez vite, mais dans un grade inférieur à celui qu’il détenait précédemment. Il effectue en effet un bref séjour à Versoix, près de Genève, en qualité de receveur principal. Les événements vont vite à cette époque et, dès le ler août 1814, l’ex-directeur à Foligno est muté à Antibes. Il lui faudra attendre 1816 pour retrouver, à Digne, un poste de directeur. Et encore s’agit-il d’un emploi moins bien rémunéré que celui dont les événements l’ont privé deux ans plus tôt.
Montpellier sera l’ultime affectation d’Emmanuel d’Obsen et en même temps sa dernière résidence; il y mourra en effet en 1833, en activité de service. Dans les cartons de ses bureaux particuliers, il laissera, pense-t-on, un volumineux sommier qui figure aujourd’hui aux archives départementales de l’Hérault. Il s’agit du registre où ont été inscrits, de 1809 à 1814, les signalements des agents des bureaux et officiers des douanes exerçant en Toscane. Emmanuel d’Obsen, dernier directeur à Foligno l’aurait sauvé lors de l’évacuation de l’Italie. Sans doute se considéra-t-il par la suite comme le gardien naturel de ce document. On peut gager que l’un de ses successeurs, Jacques de Saint-Quentin, éprouva quelque surprise à découvrir la présence de ce sommier dans les archives de sa circonscription : son signalement y avait été inscrit le premier, un quart de siècle plus tôt ! (2).
(1) J. Tulard, Fayard, A. Fierro, Histoire et Dictionnaire de la Révolution française, H. Luiront, 1987.
(2) Archives départementales de l’Hérault, 5 P 210 – Cf J. Clinquart, Douane et douaniers en Languedoc méditerranéen, Neuilly-surSeine, 1987.
Francois di Pietro, le « doux François»
Né à Aix-en-Provence en 1787, François Di Pietro était d’un an l’aîné de Boucher de Perthes. Ils se sont connus à Gênes où ils avaient été simultanément affectés lors de l’entrée de l’ex-République ligurienne dans le territoire douanier français. Tout de suite, il se lièrent d’amitié, ayant les mêmes goûts et la même joie de vivre. Di Pietro appartenait à une famille romaine en vue, mais pour des motifs vraisemblablement politiques, son père avait dû quitter les Etats pontificaux. Il était le parent d’un membre éminent de la Curie (1).
Sans aucun doute fort désargenté, le jeune Di Pietro avait dû chercher un emploi. Il l’avait trouvé dans l’administration des douanes. Il semble que ses études aient été plus poussées que celles de son ami ; en tout cas, tous deux s’intéressent à la littérature et à la musique. Sur le plan professionnel, Di Pietro – qui ne bénéficie pas des mêmes appuis que Boucher de Perthes – doit compter essentiellement sur ses méri- tes personnels pour accéder aux emplois supérieurs. Apparemment, il réussit à appeler l’attention de son directeur puisque celui-ci lui confie, dès 1809, les fonctions de premier commis dans son bureau particulier. Quand Boucher de Perthes quitte Gênes et se sépare ainsi de Di Pietro, une correspondance régulière s’établit entre les deux jeunes gens. Si l’on en juge par les lettres publiées dans “Sous Dix Rois”, il y est beaucoup question de belles lettres… mais aussi de belles dames. Le ton de cette correspondance est très affectueux : « Mon doux François, », écrit souvent Boucher de Perthes.
En 1813, Di Pietro est muté de Gênes à Rome. Certainement a t-on voulu alors tirer parti de la notoriété de son nom dans la capitale de la Chrétienté. L’évacuation de l’Italie le ramène, en 1814, dans le Midi de la France. D’abord commis dans les bureaux du directeur à Toulon (le père de Romain Bains qu’il avait connu à Gênes), il est ensuite affecté dans la direction de Cette, au poste de contrôleur principal des salins de Péquais, à Aigues-Mortes (2).
Boucher de Perthes le félicite de cette promotion : narquois, il observe que le nouveau titre de son ami forme un alexandrin ; comparativement, ceux de receveur principal ou de directeur ne présentent aucun intérêt (prosodique évidemment) ! L’amitié très vive qui, durant les années italiennes, a uni les deux jeunes gens va tiédir au fil des ans, mais Boucher de Perthes continuera de correspondre de loin en loin avec Di Pietro et il en fera, jusque dans sa vieillesse, un éloge soutenu. Di Pietro, ainsi placé par un hasard de la vie au beau milieu des salins, va s’attacher à Aigues-Mortes ; il en deviendra l’historien (3). Nommé sous-inspecteur à cette résidence en 1821, puis à Agde en 1825, il quittera ensuite le Languedoc pour la Haute-Provence, avant d’être envoyé en qualité de conseiller technique auprès de la douane péruvienne. Après avoir _ été chef de service aux Antilles, il sera nommé di- recteur à Alger en 1844 et il y terminera sa carrière en 1852. Il mourra à Paris quelques années plus tard.
Di Pietro, écrira Boucher de Perthes en 1854, « n’a jamais… éprouvé ce qu’on appelle de grands revers de fortune, mais il n’a jamais non plus eu ce qu’on appelle du bonheur… Sa carrière administrative (a) été entravée, et… il n’a pas obtenu tout ce que ses moyens supérieurs et sa conduite exem- plaire méritaient ; mais il acquit quelque chose de mieux et de plus rare : c’est une estime contre la- quelle il ne s’est pas élevé une seule voix ».
(1) Mgr Di Pietro (1747-1821) est l’un des personnages les plus importants du pontificat de Pie VII. Son rôle dans les négocia- tions qui aboutirent au Concordat est de premier plan.
(2) L’orthographe usuelle est Pecais. Les salins de Pesais étaient les plus importants de la région d’Aigues-Mortes. Pour en savoir plus, voir Jean Clinquart u Douane et doua- niers en Languedoc méditerranéen» Neuilly S/Seine, 1987, p. 45 et suivantes.
(3) François Funk Di Pietro, Histoire d’Aigues-Mortes, 1819, Paris.
Jacques Saint-Quentin
Jacques Philippe Joseph Saint Quentin offre, on l’a vu d’autre part, un bel exemple de l’extrême mobilité des fonctionnaires des douanes de l’Empire. Né en 1775 à Valenciennes (comme Brack auquel il est apparenté et qui le protège sans aucun doute), il commence sa carrière comme économe des hôpitaux de l’Armée du Nord en Hollande. A 28 ans, il est surnuméraire à la direction des douanes de Mayence, mais – fait peut courant – il obtient, huit mois après son entrée dans l’administration, un poste de receveur dans la direction de Cologne. Grâce, on l’imagine, à l’intervention de Brack, il est muté, sept mois plus tard à Agay, toujours comme receveur. Il occupe ce poste moins d’une année puisqu’il accompagne Brack à Gênes en 1805, en qualité de vérificateur.
Lors de la création de la direction de Toscane à la fin de 1808, il part pour Florence avec promotion au grade de sous-inspecteur. Dès le début de 1810, il est inspecteur divisionnaire à San-Stefano. Il y restera 2 ans, jusqu’à ce qu’on le mute, dans la même qualité, à Leer, direction d’Emden, en Allemagne du Nord. Ramené ensuite à Dunkerque, il y connaît enfin une longue période de stabilité puisqu’il demeurera dans cette ville pendant plus de quinze ans. A t-il, sous la Restauration, souffert d’être catalogué comme bonapartiste ou libéral ? On le subodore, car sa carrière, très rapide jusqu’en 1815 , longuement bloquée ensuite, repart brutalement, au lendemain des Trois Glorieuses. Nommé directeur à Bastia en 1830, il terminera sa carrière à Montpellier en 1845 à l’âge de 70 ans. Comme beaucoup de ses collègues, Saint-Quentin a eu le souci de placer ses enfants dans l’administration : deux de ses fils travailleront même comme commis dans la circonscription paternelle ; ils ne connaîtront cependant pas un destin très glorieux dans les douanes.
.
Une dynastie douanière : les Hains
Les Hains nous offrent un bel exemple de cette aristocratie douanière dont les feuilles corporatives dénonceront sous 1a Monarchie de Juillet, et plus tard encore, la mainmise sur les postes de direction.
Le fondateur de la dynastie (sous réserve de ce que pourraient nous apprendre des recherches généalogiques plus poussées) est Jean-Nicolas Hains. Sous la Ferme générale, il appartient à l’encadrement supérieur, avec un emploi de Contrôleur général qu’en 1773 il occupe à Varennes, dont la fuite malheureuse de Louis XVI fera, quelques années plus tard, l’une des localités les plus célèbres de France. A la fondation de la Régie des douanes nationales, il est nommé inspecteur à Montmédy avant d’être placé, en 1794, à la tête de l’inspection commerciale de Longwy. De 1798 à 1816, il occupe le poste de directeur à Toulon; situation qui paraît avoir particulièrement agréé à la famille Hains puisque l’un des fils et l’un des petits-fils de Jean-Nicolas l’exerceront après lui.
Deux fils de Jean-Nicolas vont suivre la carrière paternelle. Le plus célèbre est l’aîné, Antoine Romain Nicolas. Né à Varennes en 1773, il a pour parrain son grand-père maternel, ancien procureur au Parlement, représenté au baptême par l’oncle du nouveau-né, receveur général des Fermes à Clermont. Sans doute commence-t-il sa carrière sous la Ferme générale. Th. Duverger, qui l’a bien connu, dit qu’« entré de bonne heure dans la carrière… il avait su profiter de .son passage, quoique rapide, par tous les grades » et que« son expérience et son mérite l’avaient placé de suite hors de ligne »(1). De fait, il accède à 38 ans au grade de directeur, fonction qu’il exerce à Emden dans les départements hanséatiques. Il s’y distingue par son énergie. Les événements de 1813 le rendent disponible. En 1814, pendant la première Restauration, Saint-Cricq, nouveau chef de l’Administration, lui confie la mission délicate de remettre de l’ordre dans la Douane de Bordeaux. Duverger rapporte cette affaire dans les termes suivants :
« Lorsque, au mois de mars 1814, la flotte anglaise était entrée dans la Gironde, le directeur de Bordeaux, se conformant d’ailleurs à l’ordre circulaire du 17 novembre 1813 de se retirer devant l’ennemi, avait suivi le préfet à Angoulême, emmenant avec lui non seulement le personnel armé, mais encore tous les chefs et employés de la Douane, moins toutefois quelques hommes du pays que leurs intérêts retenaient à la ville. Mais la flotte anglaise ramenait le duc d’Angoulême, dont la présence détermina à Bordeaux la révolution du 12 mars, la proclamation du gouvernement royal, enfin la reconnaissance du prince comme son représentant, sous le titre de lieutenant général du royaume.
Un des premiers actes du lieutenant général fut la réorganisation de la douane, où naturellement s’enchâssèrent les agents qui n’avaient pas suivi leur directeur, et qui, donnant à cet acte coupable l’apparence du royalisme, obtinrent les premiers grades. Mal conseillé, le directeur était revenu seul d’Angoulême et avait, par sa présence, consacré cette organisation anormale, et l’ignorance et l’impéritie de la nouvelle douane avaient promptement porté leurs fruits.
L’administration centrale apprît bientôt que plus de vingt cargaisons de l’étranger avaient été librement déchargées ou transbordées en rivière, et que les chefs et employés de la douane de Bordeaux, livrés aux réjouissances du retour de la royauté qui se continuaient dans sa ville, n’avaient pas encore rétabli le service du port ; en un mot qu’une source importante d’un revenu si nécessaire alors se trouvait tarie.
M. de Saint-Cricq n’hésite pas, court au duc d’Angoulême, lui expose le mal et sait en obtenir une commission de délégué du prince en faveur de M. Hains, qu’il envoie à Bordeaux. C’était déjà un acte habile; mais il n’y eut pas moins d’habileté dans le choix du délégué. Envoyé à Bordeaux, terrain qu’il avait étudié comme inspecteur principal, M. Hains y eut bientôt rétabli le service sur ses véritables bases, et mettant une adresse extrême dans la dislocation de la composition du 12 mars, il assura les intérêts du Trésor et obtint du prince la complète ratification de ce qu’il venait de faire et défaire ».
De retour à Paris, Antoine Hains traverse les Cent-Jours sans difficulté et probablement en évitant, comme Saint-Cricq, de trop s’afficher. En tous cas, il n’est pas suspecté de bonapartisme au retour de Louis XVIII, et Saint-Cricq peut en faire le chef de l’Inspection générale des douanes, lorsqu’en 1815 il reconstitue ce service (supprimé en 1814) et lui donne une impulsion nouvelle. « Premier inspecteur général », Antoine Ilains siège alors au Conseil d’Administration des douanes.
En 1817, « M. Hains, relate encore Duverger, accomplit, et avec un succès durable, sa plus importante mission. Marseille, qui avait perdu sa franchise en 1794, et dont la guerre avait complètement anéanti le commerce, demanda et obtint, au retour des Bourbons, en 1814, le rétablissement de cette franchise, sans laquelle elle ne croyait pas pouvoir recouvrer son ancienne splendeur. Trois années d’expérience de ce vieux système et des gênes de toute sorte qu’il imposait aux habitants, aussi bien qu’aux fabricants et au commerce, pour assurer le recouvrement, non plus des droits des fermiers généraux, mais de ceux du Trésor public, avaient suffi pour exciter les plaintes les plus vives. Imbus du préjugé qu’ils ne pouvaient prospérer sans la franchise de leur port et de leur ville, les Marseillais voulaient qu’on la leur conservât, tout en levant les entraves qui étaient mises à leurs rapports avec la mère patrie, avec les colonies. La guerre les ayant empêchés de profiter du droit d’entrepôt que leur avait concédé la Convention nationale, et que la loi de 1803 avait développé, ils n’en comprenaient pas les avantages. Le mécontentement de cette population méritait d’autant plus l’attention du gouvernement que, depuis l’ordonnance libérale du 5 septembre 1816, les passions politiques, excitées par le parti ultra-royaliste, bouillonnaient dans tout le midi de la France.
M. Hains fut envoyé à Marseille. Habile et insinuant, connaissant bien le terrain, presque citoyen d’un pays où il avait des relations de famille, il réussit à faire demander, par le commerce lui-même, la suppression de la franchise et son remplacement par un large système d’entrepôt. En un mot, il amena cette incandescente population à recevoir, et avec raison, comme un bienfait, l’ordonnance du 10 septembre 1817. Effectivement, depuis 1817, la prospérité du port et de la ville de Marseille a pris un immense développement toujours croissant, auquel la conquête de l’Algérie. est venu sans doute aider, mais qui a sa source et sa cause dans les libertés commerciales concédées par l’ordonnance de 1817 ».
Le principal titre de gloire d’Antoine ilains réside toutefois dans le rôle important qu’il joua sous la Restauration, tout d’abord, dans la « moralisation » d’un service fortement perturbé par les bouleversements nés de la Révolution et des guerres de l’Empire, et ensuite, dans la direction même de ce service.
En effet, nommé Administrateur en 1822, il devient, à partir de 1824, quand se succèdent, comme directeurs généraux, des politiques étrangers à la douane, une véritable Eminence grise. Lors de la Révolution de 1830, il s’en faut de peu qu’il ne devienne officiellement le Chef de l’Administration II l’est en tout cas par intérim pendant un an environ. S’il n’obtient pas de l’être officiellement, c’est uniquement parce qu’il refuse, à la fois d’être directeur de l’administration et non directeur général, et de souscrire à une seconde et définitive suppression de l’Inspection générale. Cette attitude courageuse le contraint à l’effacement et il se contente du siège de Maître des requêtes au Conseil d’Etat qu’il occupe depuis 1830.
Cependant, cinq ans plus tard, il demande l’emploi (fort rémunérateur) de receveur principal à Marseille. « Il y aurait, je crois, plus que de la sévérité, écrit Th. Duverger, à scruter les motifs qui obligèrent le père d’une nombreuse famille à sortir de sa tente ». C’est à Marseille qu’en 1841, Antoine Hains, encore en activité, décède à l’âge de 67 ans.
Son frère Romain-François Aldegonde, d’un an son cadet, fait une carrière moins brillante, mais néanmoins très honorable. C’est lui dont le jeune Boucher de Perthes fait la connaissance à Gênes en 1805. Il y est sous-inspecteur. Le futur auteur de “Sous Dix Rois” le dépeint alors comme « d’une dévotion un peu outrée; au reste, un excellent homme». En 1809, il rereviendra sur le chapitre de la piété dans une lettre adressée à son père. « Vous savez, écrirat-il, combien M. Hains le père est dévot (il s’agirait donc de Jean Hains, le directeur de Toulon) : il en est de même. de tous ses enfants. L’aîné (ce serait vraisemblablement Antoine Hains), homme des plus distingués d’ailleurs, était franc-maçon, ce qui, à ce qu’il paraît, déplaisait beaucoup au père. Ces jours derniers, le bruit s’est répandu que nains avait été se jeter aux pieds du pape et lui a demandé à être relevé de son serment de franc-maçon et qu’il ne l’avait obtenu que moyennant amende honorable et abjuration publique, qui dit-on, a eu lieu dans une église de Savone. On ajoute que M. Hains a été signalé à l’instant même dans toutes les loges d’Italie et d’Allemagne et qu’il est à craindre que ses anciens confrères ne lui fassent un mauvais parti. Si tout ceci est vrai, il n’a pas l’air de s’en. soucier beaucoup, car il n’en est pas moins de bonne humeur ».
Quoiqu’il en soit, le cadet, Romain, succède à son père comme directeur à Toulon en 1816, à l’âge de 42 ans, avant de poursuivre et achever sa carrière en la même qualité à Marseille, de 1820 à 1832. Les frères Antoine et Romain Hains ont eu chacun, parmi leurs enfants, un fils qui accéda au grade de directeur. Nicolas, le fils d’Antoine, débute en 1828 à la direction générale auprès de son père. Sous-inspecteur à 27 ans, inspecteur à 30, il est directeur à Caen à 42 ans et passe ensuite à Bordeaux où il meurt en 1863 en activité de service. Jean, le fils de Romain, débute en 1827 à Marseille, lui aussi auprès de son père. Il est inspecteur à 31 ans et directeur à Alger à 44 ans. On le retrouve à Grenoble, puis à Toulon où, de 1861 à 1868, il occupe le fauteuil où son père et son grand-père s’étaient assis avant lui.
(1) Th Duverger, La Douane française, Paris 1858.
(1) Cahiers d’histoire des douanes françaises
N° 6 – Septembre 1988 (Numéro spécial)
Bicentenaire de la naissance de Jacques Boucher de Perthes
« père de la préhistoire » et fonctionnaire des douanes 1788-1988)