Immortels fils de douaniers
Nous reproduisons ici des extraits du catalogue établi par Michel Boyé, Conservateur du Musée des Douanes, assisté de Nelly Coudier et de Marie-Claude Buot à l’occasion de l’exposition temporaire consacrée à Henri de Régnier, Paul Valéry et G. Lenotre, intitulée “Immortels fils de douaniers” et inaugurée le 14 avril 1992.
L’équipe de rédaction
Henri de Régnier, « le discret gentilhomme »
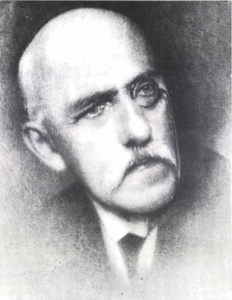
I) Une enfance « à l’ombre de la lieutenance » (1)
Si l’on suit Emmanuel Buenzod, « originaires de la Thiérache, petit pays dépendant autrefois de la Picardie et qui forme aujourd’hui une partie de l’Aisne, les ancêtres (paternels d’Henri de Régnier) prirent part aux guerres de la Ligue, gouvernèrent leurs seigneuries et furent fidèles au service du Roi jusqu’à la Révolution et au-delà. Du côté maternel, on trouve, après un du Bard de Chasans qui fut conseiller au Parlement de Dijon, un du Bard de Curley qui, par son alliance avec une demoiselle de Guillermin, compléta l’ascendance provinciale » (2).
Henri de Régnier a volontiers parlé de ses ascendances maternelles (3). Il n’a pas pour autant mis le boisseau sur son côté paternel qu’il a évoqué, certes brièvement, mais avec tact et exactitude et l’on peut s’étonner des erreurs véhiculées par la suite (4). Écoutons-le parler de son grand-père, fils de François Régnier, seigneur de Vigneux et de Rocan, capitaine au régiment de Royal-Dragons et de Henriette-Charlotte de Léonardy, épousée le 30 novembre 1779.
« …C’était un homme rude, autoritaire et hautain que mon grand-père Charles-François-Henri de Régnier, un homme de l’ancien régime, un ci-devant. Les portraits que j’ai de lui me le montrent déjà âgé, de taille moyenne, la tête forte et sévère, le nez aquilin, le front haut, les cheveux blancs, tondus de près, le visage soigneusement rasé. C’est ainsi qu’il m’apparaît dans mon souvenir, car il ne mourut que le 9 août 1877. Il était né le 24 janvier 1789 au château de Rocan, près de Sedan. Enfant, il avait suivi son père et sa mère en émigration et était entré en France le 17 Prairial an X. Le 10 Germinal an XI, il avait obtenu un certificat d’amnistie. En 1815, il avait suivi à Gand le Roi Louis XVIII et s’était enrôlé comme volontaire dans l’Armée Royale de Belgique sous les ordres du duc de Berri, dont lui fut donné certificat le 26 juillet 1816. Il était à cette époque sous-inspecteur des Douanes à Armentières. Il en fut par la suite directeur à Lorient et à Vannes. Il avait été nommé chevalier de la Légion d’Honneur par brevet du 18 mai 1826 … » (5).
Henri de Régnier maniait le raccourci pour évoquer la carrière douanière de son aïeul. Ce-lui-ci était en effet entré comme surnuméraire à la Direction Générale des Douanes le 1er octobre 1805 et avait gravi les échelons dans les territoires annexés : quatrième commis à Cologne en février 1807, puis commis aux expéditions en novembre 1809 et visiteur en août 1810, muté comme vérificateur à Hambourg en février 1811, commis principal à la navigation à Embden en septembre 1813, de nouveau vérificateur mais à Mayence le 1er janvier 1814, avant de revenir en France comme liquidateur à Maubeuge en août 1814 et d’accéder au grade de sous-inspecteur à Armentières le 1er novembre 1815.
Charles de Régnier exerça ensuite dans la direction de Charleville, puis à Bordeaux de janvier 1818 à novembre 1820. C’est dans l’Hôtel des Douanes de Bordeaux que naquit, le 28 septembre 1820, son fils Henri-Charles, le père du futur écrivain. Promu inspecteur le 1er décembre 1820, Charles de Régnier fut muté à Courcelles (direction de Thionville), puis à Rocroy en juillet 1822, enfin à Rouen le 1er septembre 1831 (6).
« … Mon père, poursuivit Régnier, aurait aimé être marin, mais sa mauvaise vue l’en empêcha (…). A Lorient, à Vannes, il était réputé pour sa hardiesse (…) mais il dut cesser ses exploits nautiques pour entrer dans l’administration des Douanes. En 1855, il reçut un poste en Corse, à Bastia (…). Durant un voyage d’Italie, il séjourna à Rome. Ce fut à son retour qu’il épousa ma mère, Thérèse-Adélaïde-Adrienne du Bard de Curley, fille d’Alexandre du Bard de Curley et d’Octavie de Guillermin. Le mariage fut célébré à Paray le 26 octobre 1857, ma mère avait 21 ans et mon père 37, lui, étant né à Bordeaux le 21 septembre 1820, elle, à Paray, le 8 janvier 1836. Après leur mariage, mes parents habitèrent à Saint-Laurent du Var, à Bordeaux et à Honfleur où je suis né. D’Honfleur, mon père fut nommé en 1871 receveur des Douanes à Paris. Nous y arrivâmes au lendemain de la Commune … Mon père était un homme doux et bon, au beau visage clair et coloré, aux yeux très bleus. Sa barbe et ses cheveux étaient blancs, d’un blanc argenté, je l’ai toujours connu ainsi. Sa vie était ordonnée, simple, assez solitaire. Il fréquentait peu le monde, aimait la lecture, les longues promenades … Je lui garde, ainsi qu’à ma mère, une vive reconnaissance de la bonté avec laquelle ils ont accueilli mon goût pour les lettres … » (7).
Cette douceur paternelle était connue de tous, y compris dans l’Administration: ne lit-on pas dans son dossier de l’année 1875 l’appréciation suivante : « très doux, je dirai même inoffensif » ?
Henri de Régnier naquit donc à Honfleur le 28 décembre 1864 mais « il est demeuré avare de confidences sur les sept années qu’il vécut à l’ombre de la Lieutenance ». La nomination de son père comme receveur du port Saint-Nicolas (8), en 1871, lui permit de faire ses études secondaires au Collège Stanislas et de constater que « ses premières ébauches versifiées » n’étaient pas du goût de certains de ses professeurs. Mais il persévéra. Bachelier dès 1893, Henri de Régnier choisit de poursuivre des études de droit sans renoncer pour autant à son « goût pour les lettres » qu’entretenait alors le prestige des mardis de la rue de Rome.
II) Une vie consacrée aux lettres
Frais émoulu de l’Université, auteur de deux plaquettes, « Les lendemains » et « Apaisement », Henri de Régnier fut dès 1885 admis chez Mallarmé, au nombre « des disciples charmés par les propos du maître sur la poésie et la musique ». D’abord attaché à la jeune école symboliste, il devait peu à peu prendre ses distances avec l’esthétique mallarméenne. Sa personnalité s’affirma et Régnier y gagna une célébrité grandissante avec la publication en 1890 de « Poèmes anciens et romanesques » et, surtout, au lendemain de la parution en 1892 de deux essais de prose poétique, « Contes à soi-même » et « Le Bosquet de Psyché ».
Recommandé pour les samedis de la rue de Balzac, Henri de Régnier fréquentait aussi régulièrement le salon de José-Maria de Heredia – qui serait élu le 22 février 1894 à l’Académie Française – et se montrait des plus assidus, avec son ami Pierre Louÿs, auprès des demoiselles Heredia (9). La cadette, Marie, avait distingué Louÿs mais, dès la fin de l’été 1894, des potins circulaient mariant Marie à Henri de Régnier qui venait d’essuyer, en juin, un four retentissant avec la présentation de « La Gardienne » au théâtre de l’Oeuvre. Il est vrai que la situation financière de José-Maria de Heredia, joueur invétéré, était si compromise qu’un mariage avec Régnier, seul, pouvait éviter le scandale. La rumeur se confirma et malgré ses pleurs, Marie épousa Henri de Régnier le 15 octobre 1895. De cette union, le poète devait retirer qu’un « Surcroît de lustre » et quelques thèmes pour ses romans, tant il connut d’épreuves, à commencer par un duel avec Robert de Montesquiou le 9 juin 1897 (10).
Cette même année, Henri de Régnier publiait « Jeux rustiques et divins » et descendait le Rhin avec son épouse. En octobre 1898, quelques semaines après la naissance de Pierre de Régnier (11), Henri et Marie partaient à Amsterdam, avec Pierre Louÿs, prenant prétexte d’une exposition sur Rembrandt. En septembre-octobre 1899, les Régnier partirent à la découverte de Venise et de Florence avant de s’embarquer au Havre, le 17 février 1900, pour les Etats-Unis où Henri de Régnier avait accepté de faire une tournée de conférences sur la poésie française contemporaine.
A son retour, Régnier publia son premier roman, « La Double Maîtresse » ainsi que « Les Médailles d’Argile », « deux ouvrages marquants de sa production » (12). Bien que « pélerin passionné de Versailles (dont) il allait célébrer la pompe désuète de son parc dans les sonnets de « La Cité des Eaux » (1902), il était désormais obsédé par Venise où il multiplierait les séjours et que ses lecteurs retrouveraient dans « La Peur d’Aimer » (1907).
En ce début de siècle, les Régnier alternaient voyages en Italie, croisières en Méditerranée, vacances à La Baule. Dans le même temps, le nouvelliste et romancier Henri de Régnier ne cessait de publier : « Le Trèfle Blanc », « Les Amants Singuliers », « Le Bon Plaisir », « Le Mariage de Minuit », « Les Vacances d’un Jeune Homme Sage », « Les Rencontre de M. de Bréot », enfin en 1905, « Le Passé Vivant ». Qui plus est, Régnier collaborait à diverses revues et à des journaux à fort tirage, tout en composant les poèmes qu’il publierait en 1906 sous le titre « La Sandale Ailée ».
Le 2 octobre 1905, José-Maria de Heredia s’éteignait au Croisic, laissant une succession catastrophique et une famille ébranlée. Puis les voyages reprirent : été 1906, nouvelle croisière en Méditerranée conclue « par une longue escale à Venise » ; automne 1907, séjour dans la Cité des Doges achevée par un périple lombard. En 1910, Henri de Régnier faisait paraître le recueil « Le Miroir des Heures », « sans doute le plus riche et le plus varié des ouvrages de poésie dont (il) avait noué la gerbe » (13).
Ayant posé sa candidature, le 29 avril, au fauteuil du vicomte Melchior de Vogüé, Régnier était élu à l’Académie au début de l’année 1911 (14), alors qu’il travaillait à son prochain roman « L’Amphisbène ». Le 18 janvier 1912, il était reçu sous la Coupole mais il dut y supporter le réquisitoire du comte Albert de Mun contre ses poèmes.
La guerre venue, Henri de Régnier, qui avait donné « Romaine Mirmaut » au Mercure de France, « composa et eut le tort de laisser publier « 1914-1916 », mince recueil de poésies dans le goût de la rhétorique guerrière de l’époque (15). Avec la paix, Régnier publia « La Pécheresse », « le meilleur de tous ses romans par l’exceptionnelle qualité de la forme » (16) et un recueil de poèmes au titre évocateur, « Vestigia Flammae ».
Pendant les années folles, les Régnier passèrent les mois d’été à Arcachon auprès de Louise de Heredia, devenue comtesse Gilbert de Voisins après avoir divorcé de Pierre Louÿs. En 1924, cependant, Henri de Régnier, devenu critique littéraire au Figaro, voulut revoir Venise pour fêter ses soixante ans. Au même moment, « il couvr(a)it de son nom une collection de « romans littéraires » chez l’éditeur Albin Michel et y f(aisait) publier, entre autres, quelques-uns des ouvrages les plus significatifs de ses amis » (17).
Malgré quelque désaffection du public, Régnier poursuivait « sa régulière production littéraire ». Après « L’Escapade » (…), il publi(ait) plusieurs recueils de poèmes et surtout un ensemble de critiques et d’impressions, « Lui ou les Femmes et l’amour » (18). En 1930, au grand dam de son épouse, il se permit le luxe de refuser le prix « Osiris » que l’Institut lui proposait pour l’ensemble de son œuvre.
Pour Henri de Régnier, l’année 1935 fut marquée par le tricentenaire de l’Académie Française, un séjour en Suisse, à Vevey, avec Marie pendant l’été et la célébration du trentième anniversaire de la mort de son beau-père. Miné depuis plusieurs mois par une affection cardiaque, il s’était résigné à mener une existence moins active. Il n’en acheva pas moins l’écriture de « Moi, Elle et Lui » que le Mercure de France mit en vente en 1936.
Henri de Régnier mourut le 23 mai 1936 et ses obsèques se déroulèrent le 25 mai. Son fils et ses deux beaux-frères, Auguste Gilbert de Voisins et René Doumic – secrétaire perpétuel de l’Académie Française -, conduisaient le deuil. De Saint-Pierre de Chaillot, le convoi s’achemina vers le Père-Lachaise où, « non loin de la tombe de Musset, le corps du poète repose(rait) » (19) désormais.
NOTES ET RÉFÉRENCES
1) Emmanuel Buenzod, Henri de Régnier (essai), 1966, p. 28.
2) Ibid., p. 24.
3) Notamment dans « Lui », « Portraits et souvenirs », « Proses datées » et « De mon Temps ».
4) Ainsi le Mercure de Flandre de juillet-août 1928 prétend-il que le père d’Henri de Régnier était sous-préfet de l’Ordre Moral ou trésorier payeur général à Honfleur !
5) Henri de Régnier, « Lui ou les femmes et l’Amour, suivi de Donc … et Paray-Le-Monial », Paris, 1929, p. 226-227.
6) Archives Musée des Douanes.
7) Henri de Régnier, op. cit., p. 227-228.
8) Direction des Douanes d’Ile de France (dossier d’Henri-Charles de Régnier).
9) Robert Fleury, « Marie de Régnier », 1990, p. 29. Il s’agissait d’Hélène (1871-1953) qui devait épouser d’abord, en 1899, Maurice Maindron, puis en 1912 René Doumic, de Marie (1875-1963) et de Louise (1878-1930), mariée en premières noces (1899) avec Pierre Louÿs et remariée (1915) à Auguste Gilbert de Voisins.
10) A la suite d’une altercation lancée par Louise et Marie de Heredia (voir Robert Fleury, op. cit., p. 68 à 70).
11) Né le 8 septembre 1898, Pierre de Régnier était en fait le fils de Pierre Louÿs.
12) Emmanuel Buenzod, op. cit., p. 34.
13) Ibid., p. 110.
14) Archives de l’Institut de France. Henri de Régnier fut élu le 9 février 1911.
15) Emmanuel Buenzod, op. cit., p. 44.
16) Robert Fleury, op. cit., p. 241.
17) Emmanuel Buenzod, op. cit., p. 32.
18) Robert Fleury, op. cit., p. 263.
19) Emmanuel Buenzod, op. cit., p. 48.
Paul Valéry, le « Robinson de l’esprit »
I) Le fils du douanier corse
Le 31 octobre 1871, le vérificateur des douanes Barthélémy Valéry déclarait à l’état-civil de la mairie de Sète la naissance, la veille à sept heures du soir, « Grand Rue, 65, maison Cazalis-Garonne », d’un garçon que sa femme, Marianne-Françoise-Alexandrine Grassi, et lui avaient décidé de prénommer Ambroise-Paul-Toussaint-Jules.
Cette ascendance douanière de Paul Valéry devait inspirer de spirituelles réflexions à Pierre Guéguen: « un œil scrutateur serait à l’origine de son œil extralucide, qui voit clair jusqu’en ses propres obscurités … A la-base de sa défiance cartésienne, il y aurait une défiance héréditaire, loyale et systématique, exercée en vue du tribut de César. Né d’une perspicacité, il réclame d’instinct les droits de l’intelligence. Il oblige l’énorme transit des phénomènes et des noumènes, le commerce extérieur et intérieur à passer par les grandes douanes de la critique, et il ne cesse de dénoncer, déshabillant et fouillant jusqu’à l’inspiration, les fraudes du sentir » (1).
Barthélémy Valéry était né à Bastia en 1825, dans une famille de marins. C’est vraisemblablement après avoir fait son temps dans la Royale qu’il avait, comme bon nombre d’insulaires, opté pour l’administration des douanes (2). On sait qu’en 1851, nommé commis, il prenait ses fonctions à Sète (3). Dans cette ville, il prit aussi épouse, en la personne de Fanny Grassi qui appartenait à la noblesse gênoise.
Giulio Grassi, le père de Fanny, versé dans les armées napoléoniennes avec les recrues du département de Gênes, avait fait campagne sous les aigles impériales jusqu’à la blessure, reçue devant Troyes en 1813, qui lui permit de regagner ses foyers. Il s’installa à Trieste où son commerce florissant lui permit d’épouser, le 20 mai 1824, Jeanne de Lugnani qui lui donna, le 2 juillet 1831, Fanny. Bientôt inquiété par la police autrichienne pour ses sympathies italiennes, il regagna Gênes où il fut nommé contrôleur de l’agence des consulats, avant d’accepter, en 1855, le consulat de Sète (4).
Il mourut dans le port héraultais en 1874, après avoir vu naître ses deux petits-fils, l’un le 8 juillet 1863, Jules Valéry, futur doyen de la Faculté de Droit de Montpellier (5), l’autre le 30 octobre 1871, Paul Valéry.
Pendant treize ans, Sète, avec son port et ses navires, marqua l’enfance du poète qui manqua se noyer en 1874 dans le bassin du Jardin Public. Après un bref passage chez les Dominicains, il entra en 1878 en classe de neuvième au Collège. Au cours de l’été, son père avait « obtenu un congé de 30 jours pour se rendre à Londres » (6) et le directeur des douanes de Montpellier ne manqua pas d’informer le Préfet de l’Hérault de son départ. Les raisons de ce voyage, en famille il est vrai, ne sont pas connues. Dans une note « très confidentielle » du 15 février 1882, le commissaire central de Sète, jugeant la conduite et la moralité de Barthélémy Valéry « bonnes », déclarait : « Il m’est donné la certitude qu’il est Bonapartiste quoique très lié avec M. Salis député. On ne peut néanmoins lui reprocher aucun acte d’hostilité ni des propos malveillants contre la République » (7).
La même année, dans un rapport du 16 novembre, la direction des Douanes ajoutait qu’il fréquentait aussi « les consuls d’Italie et d’Espagne » et qu’il avait « quelques ressources ». Au mois d’avril 1884, Barthélémy Valéry décidait de prendre sa retraite et vint s’installer à Montpellier. Le contrôleur des douanes fuyait-il l’épidémie de choléra ou considérait-il sa carrière terminée ? On ne sait.
Paul Valéry entra donc en troisième au vieux collège, bâti par les Jésuites, et c’est à Montpellier que, rebelle aux mathématiques, Valéry renonça à son rêve de devenir officier de marine. Les lettres et la peinture allaient alors l’absorber. Après une excellente classe d’humanités en 1886, il n’obtint en fin de classe de rhétorique qu’un accessit d’anglais ; il est vrai qu’en 1887 il venait de perdre son père. L’année suivante, le baccalauréat en poche, il s’inscrivit « à la Faculté de Droit installée alors dans un vieil hôtel du XVIIIème siècle connu sous le nom de Maison Jaune » (8).
Après avoir interrompu ses études un an pour effectuer son service militaire à la caserne des Minimes à Montpellier, Paul Valéry obtint sa licence en droit en 1892. Or, les fêtes du sixième centenaire de l’Université de Montpellier avaient permis à l’engagé conditionnel Valéry de rencontrer fortuitement à Palavas Pierre Louÿs qui, séduit par le futur auteur de « Charmes », le mit en relation avec la jeunesse littéraire de la capitale et lui fit connaître André Gide.
Après un voyage à Paris en 1891 qui le conduisit à rendre visite à Huysmans et à Mallarmé, Paul Valéry fit part à son frère de sa décision d’être désormais « parisien ». Ce fut chose faite en 1894 avec son installation « dans la fameuse petite chambre de la rue Gay-Lussac, avec tableau noir et reproduction du squelette de Ligier Richier » (9).
II) Les exercices de Paul Valéry
Si Paul Valéry écrivit ses premiers vers en 1884 (10), ses premières publications de poèmes, dans la Petite Revue Maritime et le Courrier Libre, datent de 1889.
En mars 1891, paraissait dans l’Ermitage son court essai en prose – le « Paradoxe sur l’architecture » – dans lequel il analysait l’influence de la musique sur l’âme de qui veut construire. Cette même année 1891, Pierre Louÿs publiait dans la Conque, la revue qu’il dirigeait, « Narcisse parle », un poème que Paul Valéry lui avait adressé l’année précédente. Mais dans la nuit du 4 au 5 octobre 1892, alors qu’il était en vacances à Gênes chez son oncle, tenu éveillé par un orage et troublé par sa passion pour une dame aperçue à Montpellier la veille de son départ, Valéry décidait de « guillotiner l’amour et la littérature » (11).
Installé à Paris, convaincu par la lecture d’ « Eurêka » d’Edgar Poe de la primauté de la démarche scientifique, Paul Valéry se livra désormais aux exercices mathématiques dont l’avaient pourtant dégoûté ses professeurs de Montpellier. Ainsi refusa-t-il sa collaboration aux revues littéraires jusqu’au jour de 1894 où la directrice de la Nouvelle Revue lui demanda un texte sur Léonard de Vinci.
Le 15 août 1895, l’ « Introduction à la Méthode de Léonard de Vinci » – portrait intellectuel du génie – était publiée. Quelques semaines auparavant, Valéry avait été reçu au concours de rédacteur du Ministère de la Guerre, mais il n’entrerait au bureau du matériel de l’artillerie qu’en mai 1897. Aussi continua-t-il à écrire, sur l’instance de ses amis, quelques essais. En 1896, après un nouveau voyage à Londres, il entreprit la « Conquête allemande » à la demande du directeur de The New Review (12) et, surtout, en octobre paraissait dans le Centaure la « Soirée avec Monsieur Teste » dont l’écriture avait débuté en août 1894 et qui devait constituer le point de départ d’un « cycle » (13).
Le 31 mai 1900, Paul Valéry se mariait avec Jeanne Gobillard, nièce de Berthe Morizot. En juillet, il quittait le ministère de la Guerre et devenait le secrétaire particulier d’Edouard Lebey, administrateur de l’agence Havas. Cette demi-sinécure, poste privilégié pour qui s’intéressait aux événements mondiaux, lui permit « quelques années de recherches heureuses », marquées par deux déménagements, la naissance de ses enfants, des rencontres et des spectacles, des voyages et des écrits inachevés (14).
En juillet 1912, Paul Valéry entreprenait l’exercice qui allait devenir « La Jeune Parque », qu’il achèverait en pleine guerre – l’Armée n’avait pas voulu de lui – et qui serait publiée en 1917 chez Gallimard. Ce long poème – plus de cinq cents vers, « monologue d’une jeune femme, seule au bord de la mer, sous les étoiles, en proie à une inquiétude qui engendre une tentation » (15), précédait de quelques mois « Aurore », parue au Mercure de France.
Le succès fut immédiat, Valéry recherché et repris par la poésie. Il revint à ses poèmes de jeunesse pour préparer la publication de l’ « Album de vers anciens » (1920) et envisagea un recueil de ses vers actuels, « Charmes », où, accompagnés d’une quinzaine de pièces brèves, devaient prendre place « Fragments du Narcisse », « La Pythie », « Ébauche d’un serpent » et le « Le Cimetière marin » (1922).
Puis, de nouveau, Valéry renonça à la poésie. Mais son succès littéraire, s’il ne le satisfaisait pas, suscitait les « commandes » des éditeurs et, à partir de ses notes, son œuvre se construisait, lentement certes, mais abondante et variée : en 1923, il publia « Eupalinos ou l’Architecte », précédé de « L’Âme et la Danse » – deux dialogues de Platon, puis, en 1924, « Variétés I », premier recueil de ses articles et préfaces.
Nommé chevalier de la Légion d’Honneur en 1923, auréolé d’une gloire éclatante, Paul Valéry, qui multipliait les conférences, était élu le 19 novembre 1925 à l’Académie Française au fauteuil d’Anatole France, dont il prononça l’éloge, en ne le nommant qu’une seule fois dans son discours de réception, le 23 juin 1927.
De 1926 à 1930, les éditions succèdent aux éditions « Analecta », « Vers et prose », « Rhumbs », « Narcisse », « L’essai sur Stendhal » et « Quatre lettres au sujet de Nietzsche », « Littérature », « Variétés II », « Mer Marines Marins », ainsi que « Suite » et « Choses tues » ; les rencontres aux rencontres : Bergson, Jean Perrin, Rilke, Monet, Teillard de Chardin, Brunschvicg, Alain et Henri Mondor, Ida Rubinstein et Honegger, Mme Curie, Holweck et Caullery, Francis Jammes, Einstein, Wells et Tagore, Louis de Broglie et Langevin ; une croisière en Méditerranée à des voyages en Grande-Bretagne, en Belgique et en Italie.
En 1931, Valéry reçut le maréchal Pétain à l’Académie Française avant de séjourner dans les pays scandinaves et d’assister à l’Opéra à la création d’ « Amphion » dont il a fourni le livret à Honegger (Ils devaient récidiver en 1934 avec « Sémiramis »). Docteur honoris causa d’Oxford, administrateur du Centre Méditerranéen à Nice, il fut nommé en 1935 Président de la Commission de synthèse de la Coopération Intellectuelle pour l’Exposition de 1937 ; il devait à ce titre rédiger quatre inscriptions pour les frontons du Palais de Chaillot.
En 1936, année de l’édition de « Variétés III » et de « Degas, Danse, Dessin », il était élu au Collège de France, à la chaire de poétique. Les « loisirs »que lui donnèrent la guerre, il devait les employer à commencer « Mon Faust » et à rédiger son cours de poétique et le livret de « La Cantate du Narcisse » qui serait jouée au Conservatoire de Musique de Paris en janvier 1944.
Après la parution du volume ultime de « Variétés V », la Libération vit Paul Valéry à l’honneur : le 27 octobre 1944, le général de Gaulle l’invitait au Théâtre-Français où ses poèmes étaient lus, Charles Morgan disait son « Ode à la France » et le 10 décembre, à la Sorbonne, il prononçait son « Discours sur Voltaire » ; enfin, le 22 mai 1945, il lisait à son ami le prince de Monaco le poème « L’Ange » commencé en 1922.
C’est le 20 juillet que la mort frappa Paul Valéry. Ses obsèques nationales furent célébrées le 25 juillet avant qu’il ne fût, deux jours plus tard, inhumé au cimetière marin de Sète.
NOTES ET RÉFÉRENCES
1) Aimé Lafont, « Paul Valéry – L’Homme et l’œuvre », 1943, p. 13.
2) Voir Albert Laot, Histoire de la Douane en Corse, 1987, chapitre « Le recrutement », p. 141 et ss.
3) Annales des Douanes, 1945, p. 308. Barthélémy Valéry fut nommé vérificateur en 1869, contrôleur en 1880.
4) Aimé Lafont, op. cit., p. 12-13.
5) Annales des Douanes, 1938, p. 260 : « on nous annonce le décès, survenu à Sète, le 30 mars dernier, de M. Valéry, doyen honoraire de la Faculté de droit de Montpellier et frère de M. Paul Valéry, de l’Académie Française. Leur père, M. Bartholomé Valéry, avait été durant 33 ans contrôleur des douanes à Sète … ».
6) Archives Musée des Douanes, AR 322.
7) Ibid.
8) Aimé Lafont, op. cit., p. 19.
9) Claude Launay, « Paul Valéry », 1990, p. 33.
10) Jacques Charpier, « Paul Valéry », Paris, 1956, p. 10 et Claude Launay, op. cit. ,p. 31.
11) Jacques Charpier, op. cit. , p. 33.
12) Aimé Lafont, op. cit.,p. 33.
13) Claude Launay, op. cit., p. 66. Suivront en effet « Lettre d’un ami », « Lettre de Madame Emilie Teste », « Extraits du log-book de Monsieur Teste », « La promenade avec Monsieur Teste », « Dialogue », « Pour un portrait de Monsieur Teste », « Quelques pensées de Monsieur Teste », « Fin de monsieur Teste ».
14) Claude Launay, op. cit., p. 35 à 37.
15) Claude Launay, op. cit., p. 71.
G. Lenotre, le père de « 1a petite histoire »

I) Le douanier Théordore Gosselin
Le 7 octobre 1855, Charles Marie Gosselin, « âgé de trente un ans, commis attaché à la Direction des Douanes à Metz, y domicilié », déclarait à la mairie de Richemont que « Françoise Pauline Léonie Bertrand, âgée de vingt cinq ans, sans profession, aussi domiciliée à Metz, son épouse » venait d’accoucher « à Pépinville, annexe de Richemont » d’un garçon qu’il prénommait Louis, Léon, Théodore (1).
Quelques années plus tard, ce petit garçon « animé, rieur, robuste, plein de santé, les cheveux en toupet » (2) entreprenait ses premières études au collège Saint-Clément de Metz, où il fut le condisciple de Ferdinand Foch.
En 1871, la guerre achevée, l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le Reich allemand obligea la famille Gosselin – le père, la mère et leurs trois fils -, qui avait opté pour la France, à quitter le pays messin de leurs ancêtres (3). Ils abandonnèrent « l’ancien » département de la Moselle avec d’autant plus de regrets qu’ils y laissaient « autant de sérieux intérêts que d’affectueux souvenirs de famille » (4).
Charles Gosselin se retrouva « premier commis à Nancy, chargé de la mission délicate d’installer les nouvelles lignes de douane, de liquider les comptes de deux directions, dont celle de Strasbourg » (5).
Après avoir terminé ses études secondaires chez les Jésuites à Malgrange près de Nancy, ce fut donc dans l’ancienne capitale des ducs de Lorraine que Théodore Gosselin devint « étudiant en droit », qualité qu’il déclina lorsqu’il entra dans l’Administration des Douanes, le 1er février 1875, comme surnuméraire à Eberménil. Un mois plus tard, il arrivait à Paris, profitant d’une mutation de son père (6), et bénéficiait d’un premier emploi rémunéré dès le 1er novembre 1875 avec sa nomination au grade de commis à la direction des douanes de Paris, plus précisément au bureau des Batignolles.
Alors que la carrière de Charles Gosselin allait se poursuivre sous les meilleurs auspices – chef de bureau en 1881, il terminerait chef du personnel de l’Administration des Douanes (7), celle de son fils, pourtant affecté en juin 1877 à l’administration centrale après y avoir été détaché six mois, serait pour le moins modeste. Promu sur place commis principal le 1er avril 1891, Théodore Gosselin prit sa retraite le 1er janvier 1912 avec le grade de rédacteur principal obtenu le 1er septembre 1896.
Pourtant, en 1876, il était considéré comme « un jeune employé instruit, bien élevé, d’une tenue et d’une conduite excellentes, et qui a tout ce qu’il faut pour faire, s’il persévère, son chemin dans l’administration » (8). Il est vrai aussi que le receveur des Batignolles émettait quelques réserves sur le jugement de Théodore Gosselin : « généralement droit mais n’échappant pas toujours à l’influence d’une imagination vive ».
De fait, le jeune commis caressait l’ambition, non pas d’une brillante carrière administrative, mais de réussir dans les lettres. Peut-être avait-il déjà deviné, s’appuyant « sur la douceur du temps et, sans doute, (sur) une tradition illustrée par de nombreux exemples », qu’il pourrait « trouver dans l’administration l’alma mater qui lui permettrait d’atteindre à la notoriété et même (…) à la gloire en s’écartant quelque peu des chemins tracés par (ses) obligations professionnelles » (9).
Une tradition douanière veut que Théodore Gosselin « narrait à ses collègues, avec un charme inégalable, l’anecdote qui allait fournir la substance de son prochain article au Temps » (10). Car il mit un point d’honneur à fréquenter avec assiduité l’aile Napoléon III du Palais du Louvre où était installée la Direction Générale des Douanes. « J’ai un ministère auquel je dois sept heures de présence par jour, écrivit-il en 1905. J’écris des articles, je vais aux Archives, à la Bibliothèque, je déjeune dehors, je reçois des épreuves, je surveille des photographes, je dirige deux copistes, je cours les quartiers les plus excentriques à la recherche d’académiciens bienveillants… Voilà ma vie, je n’ai pas une minute, c’est idiot ».
Que pouvait penser la hiérarchie douanière d’un tel emploi du temps ? De toute évidence, Théodore Gosselin avait des chefs « compréhensifs ». En 1935, les Annales des Douanes reconnaissaient que « l’Administration des Douanes, ayant tôt fait de discerner le brillant avenir littéraire qui attendait M. Gosselin, aida celui-ci dans son ascension au firmament des lettres en ne lui imposant pas avec trop de rigueur les disciplines administratives » (11).
Pour Jean Clinquart, il ne fait aucun doute que Théodore Gosselin « ait bénéficié, au début de sa carrière d’homme de lettres, de la bienveillance de Georges Pallain, le directeur général de l’époque, lui-même intéressé, dans sa jeunesse, par le journalisme, et, plus tard, par les travaux historiques » (12). Et d’ajouter : « Gosselin lui-même a évoqué avec humour son incapacité à éliminer toute fantaisie dans ses écrits administratifs et son aptitude à obtenir, pour une même addition, des résultats sans cesse différents. Il est certain en tout cas qu’on l’affecta au bureau de la Balance du Commerce où ne se trouvaient pas réunis, à l’époque (les temps ont bien changé !), les éléments promis à une brillante carrière. Une publication corporative fit, en 1909, allusion à « un certain Lenotre qui, sous le pseudonyme de Gosselin, occupait discrètement une chaise de rédacteur aux douanes ». S’il eut connaissance de ce trait, Lenotre ne manqua pas sûrement d’en apprécier l’humour ».
II) L’homme de lettres G. Lenotre
La carrière littéraire de Théodore Gosselin débuta en 1879 avec un article publié dans Le Figaro – il s’agissait d’un récit nostalgique de sa visite au collège Saint-Clément désormais sous la botte allemande et vide car les Jésuites en avaient été expulsés -, et signé G. Lenotre. Quelle signification profonde avait ce pseudonyme ? « Le G. que j’ai mis devant, expliqua Théodore Gosselin, ne signifie ni Georges, ni Guy, ni Gaston, ni même Gédéon comme certains le croient et le disent, mais tout simplement Gosselin, qui est mon nom de contribuable » (13). Quant au patronyme de Lenotre, c’était tout aussi simplement celui d’une arrière-grand-mère paternelle, Catherine Geneviève Aimée Lenotre, que l’on disait apparentée au jardinier de Louis XIV et qui avait épousé en 1781 son bisaïeul Nicolas Gosselin (14).
G. Lenotre, « délicieux conteur » allait connaître la notoriété dès 1893 avec la publication de son premier livre par les frères Perrin, « La Guillotine », un dossier sur les bourreaux. Ainsi commençait une carrière remarquablement féconde, toute tournée vers l’Histoire. « Instaurant une nouvelle méthode pour écrire l’histoire, devenant en quelque sorte le reporter du passé » (15), Lenotre fut « sinon un inventeur, sans conteste un initiateur : il créa la Petite Histoire, ou du moins lui donna son expression définitive et son nom » (16).
Contre vents et marées, malgré les levées de boucliers de ses détracteurs, en dépit des critiques de ses ennemis qui firent courir cette épigramme :
Gosselin,
Français malin,
Prenant du mien, prenant du tien,
Prenant du vôtre,
Mettant du sien (très peu du sien),
Modestement signe : Lenotre,
G. Lenotre réussira à « faire aimer l’Histoire – et à en donner le goût – à des milliers de lecteurs » (17).
Outre de multiples articles, sa bibliographie comporte plus de cinquante ouvrages : « Paris Révolutionnaire », « Le Baron de Batz » -parus après « La Guillotine- Le vrai chevalier de Maison-Rouge (1894), le Marquis de la Rouerie, conspirateur (1895), Tournebut (1895), La captivité et la mort de Marie-Antoinette (1900), La chouannerie normande au temps de l’Empire (1900), Le drame de Varennes (1905), Les massacres de Septembre (1907), Le Tribunal Révolutionnaire (1908), Bleus, Blancs et Rouges (1912), Le roi Louis XVII et l’énigme du Temple (1920), sont les titres les plus connus.
Parallèlement à cette production, « Le Temps » publiait , sous le titre « Vieilles maisons, Vieux papiers » des études remarquablement fouillées sur le Paris Révolutionnaire » dont l’ensemble « constitue le modèle d’un genre où M. Gosselin-Lenotre, avec un talent prestigieux, s’affirme en maître inégalé » (18).
En juillet 1932, alors qu’il venait de quitter l’appartement du cinquième étage du 40 , rue Vaneau qu’il avait habité pendant cinquante-sept ans pour le 17 4 du boulevard Saint-Germain, René Doumic lui proposa le fauteuil de René Bazin. Au souvenir de sa tentative avortée de 1905, Lenotre fut d ‘abord enclin à refuser. Par ailleurs, devait-il écrire, « je suis atteint d’une émotivité nerveuse qui m’a interdit toute visite, toute réunion, tous spectacle, et m’oblige à la vie la plus calme et la plus recluse » (19).
Le 1er août, il sauta cependant le pas, posant sa candidature. Il n’accomplit pas la visite protocolaire chez les trente-neuf académiciens et se limita à leur écrire. Elu le 1er décembre, il ne put se résoudre à prononcer l’éloge de René Bazin si bien qu’il s’éteignit le 6 février 1935 sans avoir affronté « une séance publique chez l’intimidante vieille dame du quai Conti » (20).
Inhumé au cimetière de Picpus le 9 février 1935, G. Lenotre laissait d’innombrables titres que l’oubli, aidé par une critique qui ne désarmait pas, recouvrit au fil des décennies, en dépit de rééditions remarquées. En revanche, il est devenu « le chef d’une école qui s’épanouit aujourd’hui à travers les revues d’histoire et fleurit jusqu’à la radio et à la télévision » (21).
NOTES ET RÉFÉRENCES
1) A.D. Moselle (7 E 467).
2) André Castelot, Lenotre, le Balzac de la Révolution, préface de Vieilles Maisons, Vieux Papiers, Paris, 1960, p. 18.
3) Gosselin-Lenotre avait deux frères : Charles, futur capitaine, et Joseph né le 8 août 1866 à Metz. L’ascendance messine était maternelle; les Gosselin étaient en effet d’origine normande.
4) Annales des Douanes, 1904, p. 149.
5) Ibid.
6) Ibid. et Direction des Douanes d’Ile de France (dossier de Théodore Gosselin).
7) Charles Gosselin prit sa retraite le 30 avril1888 . ll mourut à Billancourt le 11 mai 1904.
8) Direction des Douanes d’Ile de France (dossier de Théodore Gosselin).
9) Annales des Douanes, 1932, p. 899.
10)Ibid.
11) Annales des Douanes, 1935, p. 105.
12) Jean Clinquart, G. Lenotre, de l’Académie Française, initiateur de la « Petite Histoire » (1855-1935), dans Les Cahiers d’Histoire des douanes françaises no 8, p. 81.
13) Ibid., p . 80.
14) Archives Musée des Douanes, Fonds Leducq (dossier Gosselin).
15) André Castelot, op . cit., p . 21.
16) Marcel Prévost, cité par André Castelot, op. cit., p . 19.
17) André Castelot, op. cit. , p . 17.
18) Annales des Douanes, 1935, p . 105.
19) Cité par André Castelot, op. cit., p. 29.
20)Ibid., p. 30.
21) Ibid., p . 20-21.

Catalogue établi par Michel Boyé
Conservateur du Musée des Douanes
assisté de Nelly Coudier et de Marie-Claude Buot

